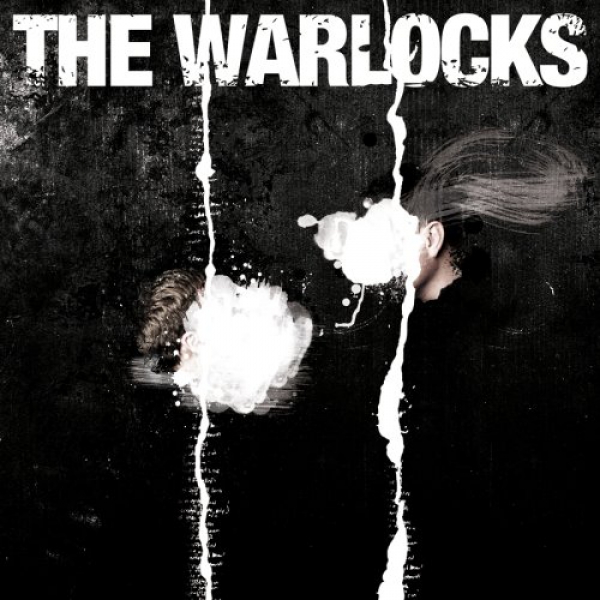The Warlocks
Phoenix
Produit par
1- Shake the Dope Out / 2- Hurricane Heart Attack / 3- Baby Blue / 4- The Dope Feels Good / 5- Cosmic Letdown / 6- Red Rooster / 7- Inside Outside / 8- Stickman Blues / 9- Moving And Shaking / 10- Oh Shadie


Pendant les quelques mois qui auront précédés et suivis la sortie de son deuxième album, The Warlocks a été le meilleur groupe de la Terre. Et pour cause, tout ce qui gravite autour est d’une classe absolue : le disque existe dans deux versions différentes avec pochettes et tracklistings disctincts (ci-dessus la version européenne chez Mute, sortie quelques mois après l’américaine sur Birdman), les visuels des posters, des flyers et des couvertures sont beaux à en pleurer, projetant dans l’imaginaire les visions d’un banquet psyché comme on n’osait plus en espérer. Surtout, la formation aligne un line-up de tous les diables. Pas moins de huit énergumènes sont nécessaires pour propulser la machine. On dénombre quatre guitares, un orgue, une basse… et deux batteries ! Ce qui fait du Warlocks de cette époque le commando acide ultime.
Phoenix pourrait à lui seul concentrer toutes les tares, critiques acerbes et autres griefs dont on a pu affubler toute la vague revivaliste des années 2000. Evidemment, quand on a choisi de porter un nom qu’ont arboré le Grateful Dead et le Velvet Underground à leurs débuts, difficile de ne pas se ramasser une sévère gerbe de sarcasmes en retour. Ramassis de passéistes opportunistes, bande de tourneurs en rond, pilleurs de tombeaux illustres, fausse sensation, vous pouvez y aller, Pitchfork s’en est chargé bien avant vous en attribuant au disque un bien méprisant 2.0. Et les coups, la bande à Bobby Hecksher les cherchait un peu, il faut bien le reconnaître, tant cet opus fléchit les genoux et courbe l’échine devant les disciples d’Andy Warhol. Le désir mimétique y carbure à plein : le chant nasillard et déphasé digne du Lou Reed de la grande époque, les guitares neurasthéniques, la drogue élevée au rang d’hygiène de vie absolue, la double batterie au jeu minimaliste dans la droite lignée de Moe Tucker…
On pourrait arguer que le véritable psychédélisme des années 2000 est davantage incarné par le Merriweather Post Pavillon d’Animal Collective qui consiste se branlotter la glotte dans l’écho sur des beats inversés pour faire chic et "expérimental" (avec l’armée de guillemets qui s’impose). Mais le rock, comme toute forme d’art aussi mineure soit-elle, n’a fait, de toute son histoire, que scruter, vampiriser, fantasmer son passé. Certains groupes ont choisi de rester dans les bornes d’un genre pour lui donner une vigueur nouvelle. Comment leur en vouloir ? La Factory a fermé ses portes depuis des lustres, Jerry Garcia n’est plus de ce monde, la contre-culture n’a pas mené à grand-chose. Que faire ? Les Warlocks répondent sur le mode romantique désespéré : tracer un cercle dont les points cosmiques relieraient Velvet Underground (quelque part entre la banane et White Light/White Heat), Spacemen 3, Can et My Bloody Valentine, soit trois décennies de décollages sous acides et de lévitations en rase-mottes, et se mouvoir dans cet espace-temps fantasmagorique en faisant comme si c’était la première fois. Et ça fonctionne démentiellement sur Phoenix (l’image de l’oiseau de feu renaissant de ses cendres n’est surement pas le fruit du hasard), plus que chez les camarades, là où le Brian Jonestown Massacre s'est toujours avéré inégal sur album, là où les Dandy Warhols ont toujours été fondamentalement un groupe pop, là où le Black Rebel Motorcycle Club a parfois péché par excès de linéarité.
Pour que la magie de Phoenix fonctionne, il faut donc être un peu coulé dans le même moule que ses géniteurs. Aborder la musique avec sensualité, que le désir monte dès la vision de la pochette, se dire que l’heure que l’on passera avec cet album ne sera pas anodine et qu’elle réclame qu’on se coupe de la réalité pendant ce laps de temps. Il n’y a de véritable trip qui ne s’envisage sans une certaine préparation. L’écoute de ce disque est donc affaire d’initiés. Sur la base que toute bonne musique agit de façon analogue à une drogue, The Warlocks concocte un fix démentiel d’une pureté et d’une puissance évocatrice comme on en a très peu croisé au cours de cette décennie. Psychédélique, Phoenix l’est jusqu’à la moelle, un psychédélisme aussi sombre que paradoxalement accueillant, aussi morne en apparence qu’il distille en loucedé une euphorie douce, un psychédélisme au charme vénéneux, ouvrant ses bras en forme de tentacules pour enserrer l’auditeur dans un cocon neurasthénique aussi enveloppant qu’un shoot de morphine. Ivresse d’avoir retrouvé l’innocence des sixties ou conscience lasse que la chose était perdue d’avance, on ne cesse d’osciller entre ces deux certitudes.
Le line-up impressionnant de la troupe inciterait à parler, selon l’expression consacrée, de cathédrale sonore. On penche plutôt pour une crypte agencée façon décor du Cabinet du docteur Caligari, paysages en trompe l’œil aux arêtes coupantes traversés par des créatures glauques et voûtées au teint pâle, tandis qu’en fond des projections kaléidoscopiques du Plastic Inevitable agiraient comme flash mentaux. Plus on est de fous, plus on trippe, mais le but visé n’est pas d’agoniser ses ouailles sous une trombe d’effets spéciaux. The Warlocks n’est pas une armée qui encercle, c’est une colonie qui avance à pas serrés. Le mur de guitares s’avère remarquablement fluide, les couches de riffs carillonnant dans la réverb, bourdonnant dans l’écho, se consumant dans un orage de fuzz crépusculaire s’interpénètrent avec une classe inouïe. Les deux batteries adoptent un jeu strictement symétrique pour dicter leur loi sans l’artifice du double tracking, elles imposent un rythme tantôt tribal, tantôt lancinant, tantôt aussi tranchant qu’une volée de lames. L’orgue quant à lui s’infiltre dans le cortex, copule avec les riffs malingres, enivre les sens et fait s’entrechoquer les neurones, pendant que Bobby Hecksher hante le décor avec la lenteur affectée d’un zombie. La conscience n’est plus maitresse en sa demeure.
Comme tout bon disque psychédélique qui se respecte, Phoenix regorge de longs périples engourdis par une défonce maximale. "Hurricane Heart Attack" ? 5 minutes 32 pendant lesquelles une citadelle proto-hard se désagrège dans le néant spatial. "Cosmic Letdown" ? 9 minutes 27 d’un rituel profane visant à désintégrer toute forme de volonté. "Inside Outside" ? 7 minutes 36 d’hypnose intense sur fond de krautrock implosant contre les parois d’une forteresse de guitares flippantes. Le "Oh Shadie" final ? N’en parlons pas, 14 minutes 16 pour un morceau qui ne semble jamais commencer et qui rejoue, goguenard, le coup des bandes inversées pour larguer l’esprit aux confins de la démence. On sort de l’expérience KO, à en ramper raide stone sur le parquet. Mais la grande force de l’affaire est de ne pas avoir oublié le mot mélodie en route. Et dans le genre, le disque regorge de formidables singles qui redonnent au rock’n’roll, beau mot qui a tellement subi d’outrages en cinq décennies, un peu de son lustre. "Shake The Dope Out" ouvre idéalement le bal, paroles nigaudes, rythme martelé comme il faut, chœurs béatement extatiques, le gimmick de rigueur et l’orgue qui se déverse en trombes au refrain pour laver nos pêchés. Parfait. "Baby Blue" fait également très fort dans le genre ballade héroïnomane adressée au Velvet. Hecksher la traverse avec lassitude et indifférence. Superbe. "The Dope Feels Good" se jette sans vergogne dans un fleuve d’insouciance chimique et laisse en état de transe. Bravo. "Moving And Shaking" tord le bras du Radiohead de The Bends pour le traîner sur les tessons d’absinthe. Magistral.
Tant d’hédonisme ne pouvait pas durer. Les Warlocks se paieront sur l’album suivant une descente aussi raide que l’ascension était grisante. Les acides tournent aigre au fond du gobelet et Surgery prend la couleur morne du désespoir. Mais les mélodies restent aussi grandioses que poignantes. Le disque emboîte le pas si logiquement à son prédécesseur que les deux opus se mettent à former les faces d’une même pièce. Les écouter bout-à-bout, d’un trait, est le genre de voyage à se flinguer le cerveau devant tant de nihilisme et de beauté. Bobby Hecksher et ses séides n’en finiront pas de sombrer par la suite. Mute les débarque car le succès n’est pas au rendez-vous. Amer, le frontman restreint ses troupes et enfonce la pédale fuzz à s’en faire péter le talon. La grâce d’hier s’efface derrière un shoegaze aux bords de l’autisme, et Heavy Deavy Skull Lover déraille sur un champ de larsens éprouvants, pas loin de l’exercice bruitiste le plus vain. The Mirror Explodes, dernière réalisation en date, corrige un peu le tir, mais Hecksher semble avoir oublié qu’il était un songwriter de talent. En attendant que la mémoire lui revienne, on n’en finira pas de se délecter, reclus dans sa cave, de ce sacré rollercoaster lysergique dont on ne s’est toujours pas remis.