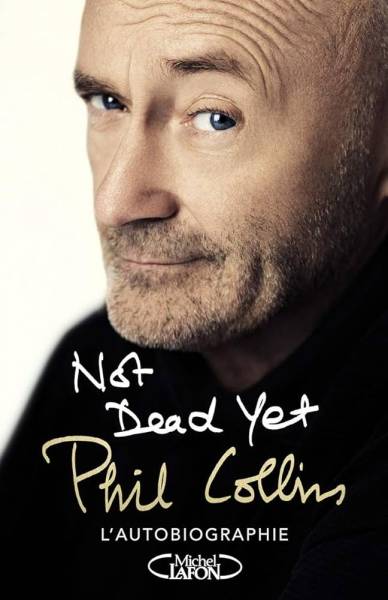Discorama 2000's : les incontournables garage
2003

mars 2003
Le passage à l'an 2000 n’a pas donné lieu à une quelconque fin du monde. Ni explosion de la planète, ni invasion de la Terre par des robots, la station Mir ne s’est pas emplafonnée Paris pleine face... On nous avait pourtant annoncé une apocalypse futuriste, un truc sale et méchant… A défaut de futuriste, sale et méchant il y eut. Les années 2000 auront sans conteste été la décennie des couples de revival garage. En 2003, à l’ombre des nouveaux héros épiques Placebo et Muse éclot Keep On Your Mean Side, le produit d’un pur minimalisme rugueux qui semble faire fi de la moindre production : voix rauque de fumeuse, boucle de guitare, boite à rythme, toux grasse et grosse ambiance lo-fi. Inspirés du duo assassin formé par Audrey Maupin et Florence Rey, The Kills sont sulfureux à souhait, un couple macabre, des Bonnie & Clyde à guitares.
Aucune innovation à l’horizon donc, mais une efficacité hors du commun : un nombre très restreint d’accord et un rythme ultra-répétitif dicté par la boîte à rythmes comme clé de voute de l’ensemble. Leurs jeux sensuels sur scène accompagneront les chansons lancinantes "Pull A U" ou "Hitched", et les brulots "Cat Claw"", Fried My Little Brains" et "Fuck The People". Une intense honnêteté se dégage du minimalisme de Keep On Your Mean Side : finalement, au sein de la discographie de The Kills, ce premier album ose le doigt d’honneur là où les suivants ne feront que la moue. Ce premier jet était tellement essentiel et brûlant qu'on s'attendait à ce que le duo se consume ou s'embourbe dans l'auto-caricature. Au lieu de cela, il a su se réinventer et est devenu un essentiel de cette décennie, et une source d’inspiration pour nouveaux méchants duos sexy bluesy.
Margaux
lire la chronique de l'album

avril 2003
Que serait-il advenu des White Stripes sans le succès interplanétaire de "Seven Nation Army" ? Nul ne le saura jamais. Mais en réussissant à pondre l'hymne définitif de la génération 2000 tout en brodant l'un des riffs les plus anthologiques de ces trente dernières années, Jack White s'est offert une importante visibilité critique et publique qui a propulsé la scène garage, le fameux revival des groupes en "The", sous le feu des projecteurs. Mieux : là où des groupes comme The Black Keys, The Greenhornes ou encore The John Spencer Blues Explosion ont échoué à se faire les apôtres populaires du blues-rock à l'ancienne, Jack et Meg White ont imposé leur minimalisme antagonique (masculin-féminin, rouge-blanc, virtuosité de la guitare - simplicité de la batterie) tout en proposant au monde une vision du rock aussi austère dans sa conception (via un enregistrement instinctif sur huit pistes et sans ordinateur) que jouissive dans sa réalisation.
En effet, réduire Elephant à son gigantesque tube introductif serait une énorme erreur tant ce quatrième album de la fausse fratrie dénote l'aboutissement de sa carrière, érigée autant comme un manifeste d'authenticité que comme une plaidoirie en faveur d'un rock brûlant, à mi-chemin entre l'urgence des Cramps et la folie maitrisée du grand Zep. Ici, Meg et ses rythmiques binaires perdent en importance au profit d'un Jack omniprésent au chant (sauf sur le délicieusement gauche "In The Cold Cold Night" chantonné par sa compagne de scène) et époustouflant de maitrise et de sensibilité aux commandes de sa Airline Res-O-Glas. Le blues se décline dans toutes ses variantes, du plus classique ("Ball And Biscuit") au plus éclaté ("I Just Don't Know What To Do With Myself", tantôt paisible, tantôt hargneux) sans oublier de nourrir une légèreté souvent drôle et toujours jouissive ("The Air Near My Fingers"). Il inspire les balades dans un style quasi-pathognomonique de White ("I Want To Be The Boy...", encore plus identitaire qu'une empreinte digitale) et s'associe à un son hérité de la fin des sixties qui aime la lourdeur et la saturation (charge équestre implacable avec "Black Math", brûlot garage enfiévré avec "Girl, You Have No Faith In Medecine") jusqu'à flirter avec le proto-metal des seventies ("Little Acorns").
Corollaire de ce succès monstre et du statut culte du disque, le monde ne fut plus jamais le même pour Jack White. Signe que sa vision aussi juvénile que rétro du rock avait à ce moment là atteint sa quintessence, il cherche depuis à explorer par tous les moyens de nouveaux horizons, que ce soit au sein de ses chers White Stripes (avec l'acoustique et controversé Get Behind Me Satan et l'éclectique Icky Thump) ou par le biais de ses deux side-projects, The Raconteurs aux côtés de Brendan Benson ou encore The Dead Weather avec Alison Mosshart. Oui, qu'on le veuille ou non, il y a bien eu un avant et un après Elephant.
Nicolas
lire la chronique de l'album

avril 2003
En 2003, Fever To Tell devient le premier album du groupe Yeah Yeah Yeahs. Et la fièvre annoncée se personnifie dans l'excentricité de sa chanteuse : Karen O. Qualifié de groupe Art-Punk, il est vrai que le trio New-Yorkais manipule habilement les écarts entre un rock intense, énervé et des expériences sonores oscillant entre musique électronique et pop. Face à ce curieux mélange des genres il est vrai que Fever To Tell a emballé les critiques à sa sortie. Mais à l'image de la musique qu'il véhicule, l'album se sera finalement rapidement consumé de lui même face à ses auditeurs. Car aujourd'hui, peu de personnes peuvent se targuer de l'avoir conservé dans leur playlist.
Les raisons ? En 2003, Fever To Tell a fait son apparition dans les bacs entre Strokes et White Stripes, ce qui explique l'engouement déjà établi pour ce revival de rock nerveux et incisif. Mais au delà de l'aspect temporel, les Yeah Yeah Yeahs, malgré leur charisme et leur talent incontestable, ne parviennent pas à créer d'album réellement cohérent de bout en bout. Ce sont des morceaux vifs qui ne possèdent pas d'attaches entre eux dans l'articulation de ce qui fait une oeuvre. Et la preuve a continué d'en être sur leur deux albums suivants : Show Your Bones (2005) et It's Blitz (2009). Tous deux manquant encore de caractère sur la durée malgré le virage électro (hélas manqué) du second. Même si Fever To Tell est un très bon album, peut-être n'a t-il pas mérité toutes ses éloges à sa sortie, peut-être que les Yeah Yeah Yeahs, bien qu'extraordinaires sur scène, souffrent de claustrophobie en studio. Pourtant, la toute récente échappée de Karen O sur l'album Were The Wild Things Are (B.O. du film Max et les Maximonstres) a montré son immense potentiel à s'approcher d'autres horizons tout en gardant cette même intensité dans la voix.
Grégory
lire la chronique de l'album

septembre 2003
Après un premier album paru en 2001, les Black Rebel Motorcycle Club reviennent sur le devant de la scène en 2003 pour invoquer les fantômes d’un rock gras et bruyant. Leur fait d’arme ? Un disque au titre à rallonge, Take Them On, On Your Own où se croisent les Stooges, le shoegaze et le Brian Johnston Massacre. Et si les californiens ne sont pas les premiers à avoir ressorti leur panoplie (perfecto, cheveux gras, clope au bec), leur second album parvient à un joli compromis entre folie 70’s et mélodie pop parfaitement ciselée. Reconnu autant pour leur jeu à l’ancienne que pour leurs prestations scéniques abrasives, le groupe atteint des sommets avec ce second opus, surfant sur la période faste "du retour du rock" entonnée par les Strokes.
Leur son a tout pour plaire : poisseux sur "Six Barrel Shotgun" ou sur" Rise and Fall", il sait se faire voluptueux sur les excellents "Shade Of Blue" et "And I’m Aching". A cette bivalence qui a fait chavirer bien des cœurs de jeunes filles en fleur, s’ajoute un charisme digne des icônes passées : le grain de voix de Robert Turner est particulièrement envoûtant. L’efficace songwriting est soutenu par une production très moderne qui tranche avec les compositions du genre. Quand Jack White affirme enregistrer sur une console analogique, les BRMC ont énormément retravaillé leur son, laissant toujours se glisser derrière les murs de guitares des mélodies aguicheuses (le très shoegaze "Heart And Soul"). C’est sans doute ce qui fait le charme de Take Them On, On Your Own : un disque qui passe le spectre du garage rock à la moulinette, qui en garde l’effervescence sans pour autant se muer en nostalgie feinte. D’une grande modernité, l’album est une déclaration d’amour au rock’n’roll, une invitation à sortir le bourbon et les Lucky Strike.
Pierre
lire la chronique de l'album