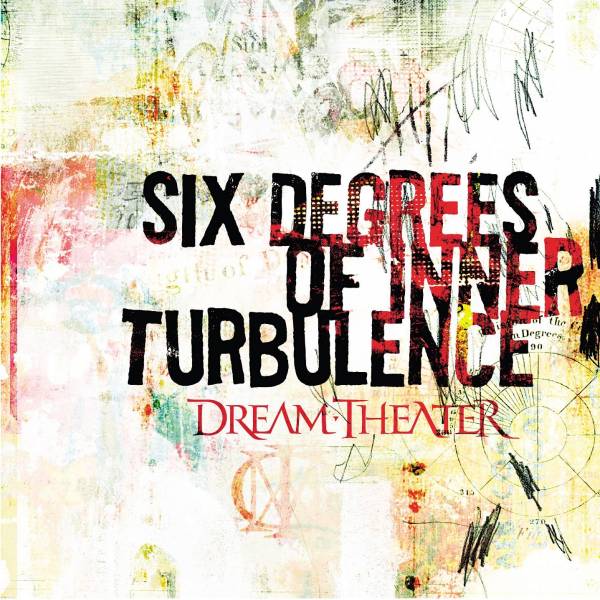
Dream Theater
Six Degrees Of Inner Turbulence
Produit par
1- The Glass Prison / 2- Blind Faith / 3- Misunderstood / 4- The Great Debate / 5- Disappear / 1- Six Degrees Of Inner Turbulence


Oui, je suis sûr de moi. Oui, j’ai vu une pub télévisée, sur TF1, à une heure de grande écoute (le dimanche entre Auto-moto et Téléfoot). Un court clip promotionnel qui vantait les mérites de Dream Theater via la sortie de leur nouvel album 6 Degrees Of Inner Turbulence. Cela peut paraitre difficile à croire en 2023, d’autant plus que mes maigres recherches sur le sujet n’ont rien donné (une vaine et rapide requête Youtube), mais je vous demande de me faire confiance. Et bien que le groupe Américain squattait beaucoup (trop) mes écoutes et mes oreilles en 2002, mon cerveau était encore suffisamment alerte pour que ce souvenir ne soit pas une pure invention de mon subconscient.
Il faut dire qu’à l’aube de la sortie de ce 6ème effort, les chantres du métal progressif venaient de frapper un grand coup avec Metropolis Part II, dont le succès fût incontestable (et incontesté, encore aujourd’hui), aussi bien du côté de la presse que du côté des fans, réputés pourtant très difficiles, comme nous l’avions évoqué dans les chroniques précédentes. Un passage promotionnel sur une grande chaîne n’est donc, compte tenu de ces éléments, pas complètement incongru. Surprenant certes, mais plausible.
Les suiveurs de Dream Theater sont à l’époque aussi impatients que fébriles, et se posent tous la même question : comment le groupe va t il s’y prendre pour donner un successeur à un album qui a gravé les tables de la loi du métal progressif moderne ? Cette question épineuse, nos New-Yorkais se la sont sans doute également posé. Le groupe revenait de très loin, n’ayant pas confirmé les promesses (commerciales) suite à Images and Words, et ayant même frôlé le split après le camouflet (pour certains fans un peu obtus) Falling Into Infinity et ses larges concessions commerciales. Mais l’arrivée de Jordan Rudess aux claviers (réclamé depuis longtemps par la fan-base du groupe, jamais avare en caprices de tout ordre) a redonné un second souffle à la formation, symbolisé sur Metropolis Part II par le retour de l’ancien logo et l’incarnation jusqu’au boutiste du fameux “concept-album”.
Des idées, les Américains n’en manquent pas, et plutôt que de livrer en pâture un Metropolis Part II Bis (et donc Ter), Portnoy et Compagnie eurent la bonne idée de livrer…un double album bourré ras-la-gueule. 96 minutes et 13 secondes au compteur (ce qui n’est jamais que 19 minutes de moins que le dernier Metallica). 2 galettes donc, mais aux intentions bien différentes : d’un côté des chansons, indépendantes, dans la tradition ce qu’à fait le groupe auparavant (comprendre des titres de métal prog avec des durées pouvant allègrement dépasser les 10 minutes), et de l’autre un seul grand titre, “Six Degrees Of Inner Turbulence” , long de 42 minutes, subdivisé en 8 parties (mais heureusement très différenciables).
En résumé, Dream Theater, pour donner suite à un concept-album… nous en livre un nouveau, doublé de 5 chansons supplémentaires, le tout en l’espace de moins de 3 ans. Sachant qu’entre temps, le fan transi aura bien évidemment acheté le triple live enregistré à New-York et sorti… le 11 Septembre 2001 (et dont l’artwork représentait les tours jumelles en feu). La “générosité” du groupe n’a d’égal que l’épaisseur des portefeuilles des fans, dans une époque où le streaming n’existait pas encore.
L’autre interrogation, pour ma pomme ce coup-ci, c’est pourquoi et comment chroniquer un disque de cette envergure (au sens littéral) en 2023 ? La raison de cette chronique est simple : c’est la seule de Dream Theater qui manque sur le site (hors albums live, faut pas pousser non plus). Pour le “comment”, j’y répondrais de manière assez simple : en le réécoutant pardi !
Et réécouter 96 minutes et 13 secondes de Dream Theater en 2023, pour moi, ex-fan repenti sorti de ce bourbier il y a quasiment 20 ans (au départ de Mike Portnoy), ça n’est pas une mince affaire. C’est un peu comme refiler une cartouche de clopes à un ancien fumeur. Il va en apprécier les premières bouffées mais va rapidement se remettre à tousser, et peut-être se sentir un peu honteux aussi. Mais m’étant débarrassé de la cigarette depuis moins longtemps que de Dream Theater, j’avais presque un peu hâte de replonger dans ces 96 minutes et 13 secondes.
Et c’est un disque qui s’avère finalement assez représentatif de tout un pan de la discographie du groupe : de très bonnes voire excellentes choses, mais aussi de très gros défauts, très conséquents. Et coup de bol qui vous fera gagner un peu de temps : les meilleurs morceaux sont sur le même “cd”.
Expédions brièvement les défauts. La longueur déjà, je l’ai plusieurs fois évoqué, et ça en devient aujourd’hui rhédibitoire, à plus forte raison pour une musique aussi chargée que le métal prog de nos conq gugusses. Ensuite, il nous faut aborder ce fameux “inspiration corner” cher au groupe. Les suiveurs connaissent ce terme puisque durant chaque composition d’album, les têtes pensantes que sont John Petrucci et Mike Portnoy définissent une série d’allbums, que la formation écoutera durant les différentes sessions pour s’imprégner d’ambiances ou d’énergies propres à certaines oeuvres. Gageons qu’en outre, l’orientation initiale de 6 Degrees Of Inner Turbulence se voulait fortement teintée d’influences très “world music”, jusqu’à ce que Petrucci et Portnoy assistent à un concert de… Pantera, leur redonnant le goût du riff et de la double grosse caisse survitaminée.
Cette idée d’Inspiration Corner trouvera son paroxysme sur Octavarium, avec des plagiats inspirations de Muse ou U2 très prononcées. Pour ce qui est de 6 Degrees Of Inner Turbulence, les références sont plus subtiles mais restent parfois un peu trop perceptibles.
Comment ne pas penser à “Solsbury Hill” de Peter Gabriel à l’écoute de "Solitary Shell", que ce soit sur le pattern de guitare ou la progression d’accords. Dommage, "Solitary Shell" est presque un des meilleurs titres de la seconde galette. “The Test That Stumped Them All” et ses atours thrashisant jouissifs aurait pu prétendre à une place de choix, mais la compo est plombée par les effets un peu ridicules sur les voix du refrain. Il en est de même sur “War Inside My Head” riffu et angoissant à souhait, mais là aussi vendangé par Jordan Rudess et ses sons de claviers co(s)miques. Pour le reste du long morceau titre, passez votre chemin, on oscille entre le grandiloquent fourre-tout “About To Crash”, “Grand Finale” et la ballade un poil trop longue pour ne pas lasser (”Goodnight Kiss”).
En revanche, le premier cd est heureusement bien plus recommandable. À commencer par la piste d’ouverture, “The Glass Prison” qui débute là où Metropolis Part II s’achevait : sur un bruit de vinyle qui tourne dans le vide. Le genre d’easter egg dont raffolent les fans du groupe. Ce morceau est le début de la fameuse “12 steps suite” de Mike Portnoy qui racontera sur cinq chansons différentes (disséminées sur chaque disque jusqu’à Black Clouds & Silver Linings) son combat contre l’alcoolisme, le titre étant même dédié à Bill W, co-fondateur des alcooliques anonyme. Un titre inaugural qui prend son temps, en étant suffisament varié (3 parties bien distinctes) pour laisser défiler les quasi 13 minutes sans sourciller, notamment grâce à la collection de riffs de Petrucci, tantôt presque néo-classique, tantôt quasi thrash. Une réussite en tous points, y compris pour le chant de Labrie, contenu dans les médiums et soutenu par les choeurs de Portnoy.
Si “Blind Faith” est davantage convenu, sans être faible pour autant, ce sont les trois dernières chansons qui vont vraiment se démarquer. L’inspiration Corner n’étant jamais très loin, on sent que le groupe a pas mal écouté les expérimentations sonores de Radiohead post Ok Computer. Une influence particulièrement saisissante sur des chansons comme “Misunderstood” ou “Disappear”, très fouillés, très produits aussi, on pense au break sur le premier nommé, qui aboutit sur des harmoniques de guitares très mordantes. Un morceau qui aurait gagné à être bien plus ramassé, les 2 dernières minutes de fade-out semblant totalement inutiles. Nos Américains étant décidément incorrigibles.
Mais il y a “Disappear”, un des trésors un peu oubliés du quintet. Derrière son intro très “Space Dye-Vest”, se trame une somptueuse composition, initiée comme une ballade, lente, mélancolique, bercée par des guitares soyeuses, des nappes de claviers discrètes et subtiles (enfin!), conférant au morceau une vraie personnalité, inhabituellement sombre, à la structure changeante, tout en restant accessible pour le commun des non-fans du groupe. Enfin, et pour terminer sur le meilleur titre de ce double album, comment ne pas frémir face aux riffs ravageurs de “The Great Debate”, longue pièce progressive de 13 minutes qui ne cache pas ses influences Toolienne du meilleur effet (le son de basse à 2’45, entre autres). Aenima faisait partie dudit “Inspiration Corner”, et cela s’entend. Jusque dans les filtres utilisés sur la voix de Maynard James Labrie. Un morceau fleuve, fort d’une thématique scientifique traitant de la question du clonage d’embryons et autres cellules souches, qui offre son lot de moments jubilatoires : le riff killer à 5’33, la double grosse caisse dévastatrice sur le break et j’en passe. Reste ce sagouin de Jordan Rudess qui ne peut s’empêcher d’en faire toujours plus sur des parties de claviers qui paraissent aujourd’hui bien lourdes et indigestes.
Mais ne boudons pas notre plaisir, “The Great Debate” est un titre phare de la période post Metropolis Part II, et permet, en compagnie d’une poignée d’autres titres, à 6 Degrees Of Inner Turbulence d’être un opus tout à fait honorable, qu’on a tendance un peu à oublier avec le temps. La faute à des albums postérieurs moins bons qui vont focaliser l’attention et cristalliser les railleries. Cf The Astonishing, disque foiré dans les très grandes largeurs, et qui a en plus l’outrecuidance d’être encore plus long que 6 Degrees Of Inner Turbulence. Un album qui, et ce coup ci, c’est certain, n’a pas bénéficié de pub télé sur Tf1.
À écouter : "The Great Debate", "The Glass Prison", "Disappear"



















