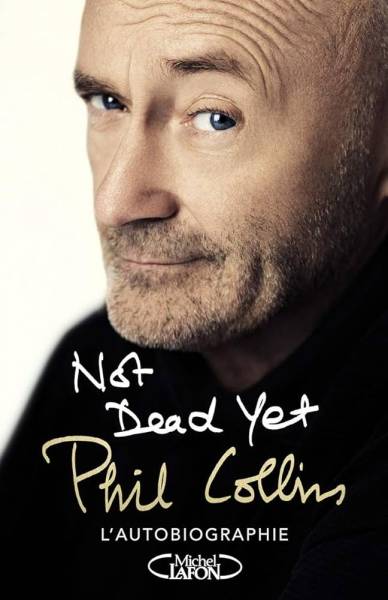David Bowie
Station to Station
Produit par
1- Station To Station / 2- Golden Years / 3- Word On A Wing / 4- TVC15 / 5- Stay / 6- Wild Is The Wind / 7- Word On A Wing (Live) / 8- Stay (Live)


Mitan des années soixante-dix...
David Robert Jones, devenu David Bowie pour ne pas être confondu avec le faux chanteur des Monkees (1), assassine son meilleur personnage (Ziggy Stardust), limoge ses Araignées de Mars (dont le remarquable Trevor Bolder) et, du haut de son altitude, décide que les frontières insulaires de sa Grande-Bretagne natale sont désormais trop étriquées pour son talent infini.
Ca, c’est l’Histoire.
Comme (dans le désordre) Rod Stewart, les Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin et tant d’autres, David envahit tout seul les Etats-Unis d’Amérique. La plupart des conquérants débarquent sur la côte Est et tentent de conquérir l’Ouest (2). Bowie file directement à Los Angeles. Il n’y a plus d’étape suivante. L’alternative est simple : soit, ça marche, soit tu rebrousses chemin ou tu pars à la nage dans l’Océan Pacifique en direction du grand Orient.
Ca ne va pas marcher. Los Angeles n’est pas une fille facile (ni agréable, au demeurant). Ses plaisirs sont des contraintes. Et la cocaïne à foison n’est pas forcément un cadeau de bienvenue.
Détruit, paranoïaque et amaigri à l’extrême (3), Bowie (attention : spoiler) abandonnera rapidement la place pour retourner en Europe où il guérira partiellement de ses addictions et absorbera les plus emmerdants mystères du Krautrock pour enregistrer sa fausse "trilogie berlinoise" (4).
Au secours !
Mais, avant de repartir pour sauver sa peau (en déclarant poliment que Los Angeles mériterait d’être rayée de la carte), l’anglais va enregistrer un album hybride, absolument marquant. Une curieuse transition entre deux mondes. Mort et Vie.
Station To Station n’est pas un disque exceptionnel. Parce qu’il est explosé entre deux titres extraordinaires, sa plage titulaire en intro et une reprise magistrale en outro. Deux merveilles qui accréditent la thèse selon laquelle une horloge dézinguée donne l’heure exacte au moins deux fois par jour.
Contrairement à ce que pourraient laisser penser les sons synthétiques de ses premières secondes, "Station To Station" n’est pas une chanson consacrée aux trains ni aux gares. Elle évoque (en toute modestie) le pénible chemin de croix de Jésus Christ. Ligne de coke après ligne de coke. From Kether To Malkuth. Quatorze empreintes douloureuses dans l’imaginaire collectif.
Avec ses dix minutes (trop courtes) au compteur, il s’agit probablement d’un des plus grands hymnes de l’histoire du rock. A la toute extrême limite parodique de Jim Steinman. Porté par des musiciens exceptionnels comme le Professeur Roy Bittan, Carlos Alomar ou Earl Slick, Bowie, christique et passionné, expédie tout le monde au tapis. C’est un convoi blindé (5) qui traverse définitivement le cerveau des auditeurs (et auditrices) lorsqu’ils/elles osent s’y perdre.
Et ça laisse des traces indélébiles.
A l’autre extrémité de l’album, il y a la plus belle chanson d’amour jamais composée. "Wild Is The Wind" a été écrite en 1957 par un américain – Ned Washington (texte) – et un russe – Dimitri Tiomkin (musique). Sa version définitive a été enregistrée (piano – basse – voix) par la douloureuse Nina Simone. Il n’y a rien de plus beau au monde. Ni de plus désespérant.
Et il est fascinant de voir qu’au plus mal de sa vie, David (fan avéré de Nina) tente ici le grand écart, en adaptant un monument qu’il étire au-delà des six minutes. L’effort (la "désespérance", comme disait Jacques Brel) que l’on ressent dans l’interprétation (jetée en pâture d’une ville cannibale) ajoute une "station" inédite au long chemin de croix du premier titre. Bowie plus fort que Jésus. Et que son copain John Lennon (6).
Les quatre autres titres méritent certainement une écoute attentive mais ils sont écrasés entre le "souvenir explosif du début" et l’"attente impatiente du final". Pour la très petite anecdote, il se raconte que "Golden Years" aurait été composée pour Elvis Presley (admettons).
La – très belle – photo en noir et blanc qui illustre la pochette est une image tirée de l’ultra-navet filmique The Man Who Fell To Earth, un ouvrage irregardable (avec David, en très mauvais acteur principal), digne du brave Ed Wood (7) en personne.
On pourrait tou.te.s être des héros, durant une seule journée ! On pourrait !
(1) ce qui situe le niveau du conflit intercontinental qui se déroule dans le monde musical…
(2) Slade, (à titre d’exemple) s’y cassera les perruques, tandis que Led Zeppelin réussira son pari (comme en témoigne vertigineusement "How The West Was Won").
(3) les multicolores costumes "bouffants" du génial Kansai Yamamoto camouflaient intelligemment le physique mortifère du Maigre Duc Blanc.
(4) même en faisant preuve d’une grande largesse d’esprit, il est difficile de parler de "trilogie berlinoise" quand le troisième album est enregistré à Montreux (en Suisse). Cela dit, si ça fait plaisir aux exégètes…
(5) il n’y a aucun rapport direct mais The Heavy Metal Hero, une œuvre magistrale de Rodney Matthews, vient inévitablement à l’esprit lorsque le titre s’emballe.
(6) John estimait que, contrairement à Los Angeles, New-York était une ville paisible et que l’immeuble Dakota était un endroit où il pouvait vivre en toute sécurité avec Yoko. Bien vu.
(7) Plan 9 From Outter Space reste, à ce jour, le film préféré du chroniqueur.