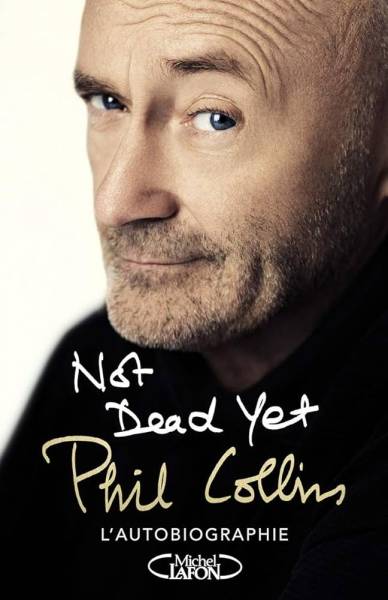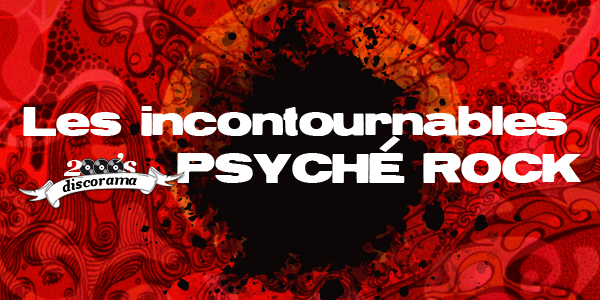
Discorama 2000's : les incontournables psyché rock
- Introduction
- 2000-2002
- 2003-2006
- 2007-2009
2003-2006

juin 2003
Pendant les quelques mois qui auront précédés et suivis la sortie de son deuxième album, The Warlocks a été le meilleur groupe de la Terre. Et pour cause, tout ce qui gravite autour est d’une classe absolue : le disque existe dans deux versions différentes avec pochettes et tracklistings disctincts (ci-contre la version américaine sur Birdman, sortie quelques mois avant l’européenne chez Mute), les visuels des posters, des flyers et des couvertures sont beaux à en pleurer, projetant dans l’imaginaire les visions d’un banquet psyché comme on n’osait plus en espérer. Surtout, la formation aligne un line-up de tous les diables. Pas moins de huit énergumènes sont nécessaires pour propulser la machine. On dénombre quatre guitares, un orgue, une basse… et deux batteries ! Ce qui fait du Warlocks de cette époque le commando acide ultime.
The Phoenix Album pourrait à lui seul concentrer toutes les tares, critiques acerbes et autres griefs dont on a pu affubler toute la vague revivaliste des années 2000. Evidemment, quand on a choisi de porter un nom qu’ont arboré le Grateful Dead et le Velvet Underground à leurs débuts, difficile de ne pas se ramasser une sévère gerbe de sarcasmes en retour. Ramassis de passéistes opportunistes, bande de tourneurs en rond, pilleurs de tombeaux illustres, fausse sensation, vous pouvez y aller, Pitchfork s’en est chargé bien avant vous en attribuant au disque un bien méprisant 2.0. Et les coups, la bande à Bobby Hecksher les cherchait un peu, il faut bien le reconnaître, tant cet opus fléchit les genoux et courbe l’échine devant les disciples d’Andy Warhol. Le désir mimétique y carbure à plein : le chant nasillard et déphasé digne du Lou Reed de la grande époque, les guitares neurasthéniques, la drogue élevée au rang d’hygiène de vie absolue, la double batterie au jeu minimaliste dans la droite lignée de Moe Tucker…
On pourrait arguer que le véritable psychédélisme des années 2000 est davantage incarné par le Merriweather Post Pavillon d’Animal Collective qui consiste se branlotter la glotte dans l’écho sur des beats inversés pour faire chic et "expérimental" (avec l’armée de guillemets qui s’impose). Mais le rock, comme toute forme d’art aussi mineure soit-elle, n’a fait, de toute son histoire, que scruter, vampiriser, fantasmer son passé. Certains groupes ont choisi de rester dans les bornes d’un genre pour lui donner une vigueur nouvelle. Comment leur en vouloir ? La Factory a fermé ses portes depuis des lustres, Jerry Garcia n’est plus de ce monde, la contre-culture n’a pas mené à grand-chose. Que faire ? Les Warlocks répondent sur le mode romantique désespéré : tracer un cercle dont les points cosmiques relieraient Velvet Underground (quelque part entre la banane et White Light/White Heat), Spacemen 3, Can et My Bloody Valentine, soit trois décennies de décollages sous acides et de lévitations en rase-mottes, et se mouvoir dans cet espace-temps fantasmagorique, en faisant comme si c’était la première fois. Et ça fonctionne démentiellement sur Phoenix (l’image de l’oiseau de feu renaissant de ses cendres n’est surement pas le fruit du hasard), plus que chez les camarades, là où le Brian Jonestown Massacre s'est toujours avéré inégal sur album, là où les Dandy Warhols ont toujours été fondamentalement un groupe pop, là où le Black Rebel Motorcycle Club a parfois péché par excès de linéarité.
Pour que la magie de Phoenix fonctionne, il faut donc être un peu coulé dans le même moule que ses géniteurs. Aborder la musique avec sensualité, que le désir monte dès la vision de la pochette, se dire que l’heure que l’on passera avec cet album ne sera pas anodine et qu’elle réclame qu’on se coupe de la réalité pendant ce laps de temps. Il n’y a de véritable trip qui ne s’envisage sans une certaine préparation. L’écoute de ce disque est donc affaire d’initiés. Sur la base que toute bonne musique agit de façon analogue à une drogue, The Warlocks concocte un fix démentiel d’une pureté et d’une puissance évocatrice comme on en a très peu croisé au cours de cette décennie. Psychédélique, The Phoenix Album l’est jusqu’à la moelle, un psychédélisme aussi sombre que paradoxalement accueillant, aussi morne en apparence qu’il distille en loucedé une euphorie douce, un psychédélisme au charme vénéneux, ouvrant ses bras en forme de tentacules pour enserrer l’auditeur dans un cocon neurasthénique aussi enveloppant qu’un shoot de morphine. Ivresse d’avoir retrouvé l’innocence des sixties ou conscience lasse que la chose était perdue d’avance, on ne cesse d’osciller entre ces deux certitudes.
Le line-up impressionnant de la troupe inciterait à parler, selon l’expression consacrée, de cathédrale sonore. On penche plutôt pour une crypte agencée façon décor du Cabinet du docteur Caligari, paysages en trompe l’œil aux arêtes coupantes traversés par des créatures glauques et voûtées au teint pâle, tandis qu’en fond des projections kaléidoscopiques du Plastic Inevitable agiraient comme flash mentaux. Plus on est de fous, plus on trippe, mais le but visé n’est pas d’agoniser ses ouailles sous une trombe d’effets spéciaux. The Warlocks n’est pas une armée qui encercle, c’est une colonie qui avance à pas serrés. Le mur de guitares s’avère remarquablement fluide, les couches de riffs carillonnant dans la réverb, bourdonnant dans l’écho, se consumant dans un orage de fuzz crépusculaire s’interpénètrent avec une classe inouïe. Les deux batteries adoptent un jeu strictement symétrique pour dicter leur loi sans l’artifice du double tracking, elles imposent un rythme tantôt tribal, tantôt lancinant, tantôt aussi tranchant qu’une volée de lames. L’orgue quant à lui s’infiltre dans le cortex, copule avec les riffs malingres, enivre les sens et fait s’entrechoquer les neurones, pendant que Bobby Hecksher hante le décor avec la lenteur affectée d’un zombie. La conscience n’est plus maitresse en sa demeure.
Comme tout bon disque psychédélique qui se respecte, Phoenix regorge de longs périples engourdis par une défonce maximale. "Hurricane Heart Attack" ? 5 minutes 32 pendant lesquelles une citadelle proto-hard se désagrège dans le néant spatial. "Cosmic Letdown" ? 9 minutes 27 d’un rituel profane visant à désintégrer toute forme de volonté. "Inside Outside" ? 7 minutes 36 d’hypnose intense sur fond de krautrock implosant contre les parois d’une forteresse de guitares flippantes. Le "Oh Shadie" final ? N’en parlons pas, 14 minutes 16 pour un morceau qui ne semble jamais commencer et qui rejoue, goguenard, le coup des bandes inversées pour larguer l’esprit aux confins de la démence. On sort de l’expérience KO, à en ramper raide stone sur le parquet. Mais la grande force de l’affaire est de ne pas avoir oublié le mot mélodie en route. Et dans le genre, le disque regorge de formidables singles qui redonnent au rock’n’roll, beau mot qui a tellement subi d’outrages en cinq décennies, un peu de son lustre. "Shake The Dope Out" ouvre idéalement le bal, paroles nigaudes, rythme martelé comme il faut, chœurs béatement extatiques, le gimmick de rigueur et l’orgue qui se déverse en trombes au refrain pour laver nos pêchés. Parfait. "Baby Blue" fait également très fort dans le genre ballade héroïnomane adressée au Velvet. Hecksher la traverse avec lassitude et indifférence. Superbe. "The Dope Feels Good" se jette sans vergogne dans un fleuve d’insouciance chimique et laisse en état de transe. Bravo. "Moving And Shaking" tord le bras du Radiohead de The Bends pour le traîner sur les tessons d’absinthe. Magistral.
Tant d’hédonisme ne pouvait pas durer. Les Warlocks se paieront sur l’album suivant une descente aussi raide que l’ascension était grisante. Les acides tournent aigre au fond du gobelet et Surgery prend la couleur morne du désespoir. Mais les mélodies restent aussi grandioses que poignantes. Le disque emboîte le pas si logiquement à son prédécesseur que les deux opus se mettent à former les faces d’une même pièce. Les écouter bout-à-bout, d’un trait, est le genre de voyage à se flinguer le cerveau devant tant de nihilisme et de beauté. Bobby Hecksher et ses séides n’en finiront pas de sombrer par la suite. Mute les débarque car le succès n’est pas au rendez-vous. Amer, le frontman restreint ses troupes et enfonce la pédale fuzz à s’en faire péter le talon. La grâce d’hier s’efface derrière un shoegaze aux bords de l’autisme, et Heavy DEavy Skull Lover déraille sur un champ de larsens éprouvants, pas loin de l’exercice bruitiste le plus vain. The Mirror Explodes, dernière réalisation en date, corrige un peu le tir, mais Hecksher semble avoir oublié qu’il était un songwriter de talent. En attendant que la mémoire lui revienne, on n’en finira pas de se délecter, reclus dans sa cave, de ce sacré rollercoaster lysergique dont on ne s’est toujours pas remis.
Maxime

août 2003
Coupons court aux préjugés. Le rock psychédélique ne se limite pas aux expérimentations arty du rock progressif ou à d'interminables morceaux noyés dans des nappes de chloroforme sonique. Le terme "psychédélique" avait fait sa première incursion dans le monde musical en 1965 avec l'album Psychedelic sounds of du Thirteenth Floor Elevator de Roky Erikson, dont le tube abrasif et immédiat (et donc à des lieues des clichés du rock psychédélique), "You're Gonna Miss Me", échoua sur la version originale de la compilation Nuggets. Collection de pépites de la "première ère psychédélique américaine" sortie en 1972, la légendaire compilation fait découvrir à une génération punk désabusée une pléthore de groupes psychédéliques méconnus tels que les Seeds, Electric Prunes ou Blues Magoos et provoque à la fin des 70's la formation de toute une vague de groupes inspirés par ces derniers.
Fers de lance de ce mouvement revival-garage aux côtés de leurs compatriotes des Fuzztones, les Chesterfield Kings, menés par le charismatique Greg Prevost, ont à grands renforts de guitares Fuzz et d'orgues électriques gavés de psychédélisme, remis au goût du jour à l'aube des années 80 le rock acidifié des mid-60's. Sorti en 1982, le premier album des Kings fait véritablement office de manifeste du genre. Entièrement composé de reprises de groupes de rock psychédélique plus ou moins obscurs de la période 65-66, Here are the chesterfield Kings pose les bases du renouveau garage : des sonorités fuzz, des orgues électriques et une production "vintage", au service de reprises ou de compositions très fortement inspirées des classiques du genre.
Avec la sortie d'une petite dizaine de LP's et malgré quelques regrettables sorties de route, la formation originaire de Rochester a su se maintenir avec une certaine sagacité dans le haut de la vague revival-garage. Une discographie des plus consistantes en somme, dont la sortie en 2007 de Mindbending sounds of the Chesterfield kings constitue sans aucun doute l'une des pièces maitresses. Avec cet album, les Chesterfield Kings font ce qu'ils savent faire de mieux ; c'est à dire pasticher leurs héros et sonner comme un groupe perdu quelque part dans les années 60. Sans la production soignée dont a bénéficié l'enregistrement de cet album, il aurait d'ailleurs probablement fallu une oreille particulièrement avertie pour situer son arrivée dans les bacs à une date postérieure à la fin des 60's. Le groupe aborde ici le psychédélisme baroque de 66-67, cette époque où clavecins, sitars et autres originalités sonores s'étaient invités dans les compositions des groupes anglo-saxons et où l'usage de psychotropes faisait , contre toute morale, partie intégrante du processus créatif. Mindbending Sounds of (un titre révélateur, référence ouverte au Psychedelic sounds of évoqué plus haut) est une invitation au "trip", parcourue de bout en bout par des soli planants, ("Mystery Trip"), des expérimentations vocales ("Trip Through Tomorrow"), des orchestrations indianisantes ("The Fading of My Mind" et "Transparent Life") ou des lignes de guitare hallucinogènes ("Non entity").
Les références du groupe sont, comme à leur habitude, complètement assumées. On reconnaît ainsi distinctement le style des Chocolate Watchband sur le très mystique "Transparent life" et sur le bien-nommé "Mystery Trip", ou celui des Stones de la fin des 60's avec le très bon "Death is the only real thing" ou "Flashback", qui reprend quasiment à l'identique le riff de "Jumping Jack Flash". "Stems and Flowers" devrait quant à lui évoquer à quelques-uns le son inimitable des Electric Prunes d' Underground. A vrai dire, on se surprend assez vite à essayer de repérer de quel groupe de l'époque est inspiré tel ou tel morceau. Et à constater que malgré le caractère très référentiel de cet album, la machine est fichtrement bien huilée. La réussite de ce Mindbending sounds est à chercher dans le fait qu'il repose exclusivement sur des compositions originales, alors même que le gang de Greg Prevost avait eu jusque là pour habitude de briller avant tout par sa capacité à déterrer et "rafraichir" avec soin des tubes oubliés des 60's. Certaines pistes du disque, à l'image de "Mystery trip" ou "Trip through Tomorrow" sont d'ailleurs clairement à classer parmi les meilleures créations du groupe...
Les Chesterfield Kings prouvent donc ici qu'ils en ont encore sous le pied, et signent avec Mindbending Sounds Of une collection de morceaux d'une qualité exemplaire, distillant le long de 14 pistes un rock tantôt nerveux, acide ou planant, ainsi que l'un des meilleurs albums d'une carrière pourtant longue et étoffée. Et, au passage, rendent un hommage sincère à une poignée de groupes dont l'impact sur l'évolution du rock psychédélique est encore sous-estimé aujourd'hui. Un album certes tourné vers le passé, mais qui fait date dans le psychédélisme musical des 00's, foyer de résistance analogique dans un monde dominé par l'électro et l'informatique.
Thomas

septembre 2003
Le succès du Songs For The Deaf des Queens Of The Stone Age a redonné un élan certain au stoner rock, bien mis en difficulté en ce début de millénaire par l’omniprésence de la baudruche nu-metal. Mais le triomphe du collectif de Josh Homme ne saurait occulter la horde de combos hallucinogènes gravitant dans l’ombre autour de son astre flamboyant. Nebula mérite certainement d’être extrait de cette masse. Né au milieu des années 90 sous l’impulsion de deux renégats de Fu Manchu, le batteur Ruben Romano et le chanteur et guitariste Eddie Glass (ancien activiste du punk west coast au sein d’Olivelawn), le power trio s’est escrimé pendant une bonne décennie à porter à ébullition maximale son stoner débridé, ou plutôt, comme ils préfèrent le nommer, leur heavy psych rock. C’est l’expression qu’ont choisi Mark Arm (Mudhoney), Dicky Peterson (Blue Cheer) et Iggy Pop pour adouber le gang californien dont ils sont de très grands fans. Cette brochette de godfathers renseigne déjà sur la teneur du propos : Nebula propose un amalgame explosif de grunge en lévitation, de hard rock ronflant et de garage-rock nocif. Avec le terme heavy psych, le groupe noue également une filiation évidente avec toutes ces formations kamikazes de la fin des années 60 qui jouèrent les apprentis sorciers en amalgamant les voyages hébétés sous LSD avec le fracas des Marshall hurlantes du hard naissant. Pensez Blue Cheer, Wizards From Kansas, Jimi Hendrix, Atomic Rooster, mais aussi la frange la plus dégénérée de l’ère Nuggets, 13th Floor Elevator et The Litter en tête.
Se reconnecter au noyau acide du San Francisco de la grande époque pour en déverser le suc lysergique sur le monde contemporain, tel est le credo martelé dès le premier EP du groupe (Let It Burn, 1996). Nebula passe à la vitesse supérieure à l’orée du nouveau millénaire en alignant des albums proprement affolants : grunge sous psilocybine piloté par Jack Endino, producteur maison de Sub Pop (To The Center, 1999) et convulsions garage captées depuis la voie lactée (dantesque Charged, 2001). Son style solidement maîtrisé, le groupe offre alors le poste de producteur à une vieille connaissance, Chris Goss (Masters Of Reality, QOTSA, Stone Temple Pilots), qu’il avait croisé avec toute la meute vadrouillant autour du Rancho De La Luna à l’époque de Kyuss. Et trouve par là-même ce qui va devenir son thème de prédilection : le voyage spatial. Que peut bien signifier ce "rituel atomique" brandi sur la pochette du troisième opus des Californiens ? Il faut effeuiller le digipack qui se déplie en plusieurs volets, façon retable de la Renaissance détourné, pour comprendre. Shades rivées sur le nez et perfecto sur les épaules, Glass tend un jack vers l’observateur. L’ambition formelle du projet reste fidèle au crédo seventies : brancher les gens. Le livret cite quelques épitres cryptiques d’Aleister Crowley, ceux-là mêmes qui seront scandés en toute fin de "The Beast". Puissances occultes et trips intersidéraux se joignent comme dans les grandes heures de gloire d’Hawkwind. La mantra qui se dégage de ce foutoir sonique est limpide : affirme-toi, fais ce qui te semble bon. La croisade cosmique est, comme souvent, ici métaphore d’un voyage intérieur aboutissant à une connaissance complète de soi, source d’une irrésistible volonté de puissance nietzschéenne.
Les trois premières pistes de l’album symbolisent ainsi la mise en branle de ce space trip : "Atomic Ritual" dresse un ultime check-up des potentiomètres avant le grand décollage, juché sur un vrombissement de guitares acerbes et de riffs ayant passé le mur du son ; on commence à percer la stratosphère sur le fulgurant "So It Goes", la carlingue tremble, les réacteurs turbinent dans le rouge, la destination se profile sur les radars : un monde où "everything is beautiful, and nothing hurts" ; survient alors "Carpe Diem" au son duquel on contemple, baba, l’immensité de l’univers, en apesanteur sur un groove musculeux cédant le pas à des boucles d’orgue hypnotiques. Après cette ouverture magistrale, Nebula ne fait ensuite qu’alterner rage éperdue et sidération sous psychotropes. "More" et "Electric Synapse" rejouent le cirque stoogien à son apogée, incitations à l’émeute, batterie débridée et décharges brutales de riffs telluriques assénées au ras des gencives. "The Way To Venus" fait quant à lui songer à une jam réconciliant les tricotages priapiques d’Hendrix avec la lourdeur forcenée d’un Blue Cheer, tandis que "The Beast" et "Out Of Your Head" jouent à fond la carte de la désintégration de la psyché, projetant dans l’esprit des visions folles dignes du Delirius de Druillet : armées immenses de colonisateurs extra-terrestres lancés dans une infinie marche au pas de l’oie, vaisseaux galactiques grandioses, explosions de lasers mauves et fluo… Glass multiplie les échauffourées, ici à la wah-wah plombée dans l’écho, là à grand renfort de fuzz bourdonnantes sur tapis de basse et de claviers ("Strange Human"). Goss maintient le tout sous un étrange couvercle. Le son se révèle aussi puissant qu’étouffé, le disque semblant sortir d’un vieux grimoire oublié. Outre son équilibre parfait, ses guitares grisantes et ses litanies trippantes, c’est cette production artificiellement surannée qui donne au disque tout son charme.
A l’aise dans ses mocassins de cuir, le groupe ne déviera plus de cette thématique space par la suite, même si, malgré leurs mérites, ni Apollo (2006) ni Heavy Psych (2009) ne seront à la hauteur de cet Atomic Ritual méphistophélique. Ruben Romano quitte bientôt la formation pour assumer son rôle de père de famille, tandis que la valse des bassistes se poursuit de plus belle. Eddie Glass pense se stabiliser à nouveau en 2008 avec l’arrivée de Tom Davies à la 4 cordes et de Rob Oswald derrière les fûts, mais ce dernier repart aussi sec chez Karma To Burn pour entamer un come-back aussi fructueux qu’inespéré. Frustré par un énième changement de line-up qui se solde à coups d’abus de poudre blanche, Glass jette l’éponge il y a quelques mois et met Nebula en pause indéterminée. Aux dernières nouvelles, il est retourné à la batterie, son premier instrument, peut-être pour assister son pote Ed Mudell (guitariste de Monster Magnet) dont on attend un album solo depuis des lustres. Puisque nos télescopes ne sont pas prêt de capter les échos du power trio dans un avenir proche, autant rester perché sur son addictif chef d’œuvre quelques temps encore.
Maxime
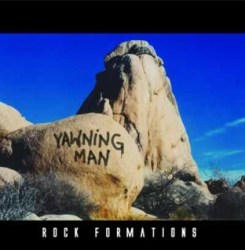
avril 2005
De tous les satellites qui gravitent autour de la Supernova Kyuss, certains se sont vus révélés par le succès colossal de son noyau flamboyant dans les hautes sphères du rock. Depuis l’avènement des Queens Of The Stone Age avec Songs For The Deaf, les chances de rencontrer les auditeurs de projets dérivés de Kyuss sont devenues plus nombreuses, mais s’il en reste un profondément enseveli sous une épaisse couche de sable, c’est bien Yawning Man. Formé en 1986, quelques années avant le combo légendaire de Palm Desert, le trio composé de Alfredo Hernandez (batterie), Mario Lalli (basse), et Gary Arce (guitare), fut l’investigateur des Generator Parties, ces soirées surréalistes en plein désert californien où le groupe commençait à jouer au coucher du soleil pendant plusieurs heures devant des jeunes en perdition, dont les futurs créateurs de Sons Of Kyuss, cherchant l’évasion dans les jams psychédéliques et mystiques de Yawning Man. Ils sont les pionniers du Desert Rock, les premiers a avoir su mettre en musique leur environnement. Leur méthode infaillible pour rester tapis sous les dunes ? Ne pas sortir le moindre enregistrement durant dix neuf ans d’existence, vadrouillant d‘un groupe à l‘autre, se retrouvant pour quelques concerts... Stupide dites-vous ? Peut être simplement un choix. Après tout, chacun donne la direction qu’il désire à sa musique, là où il pense que se trouve sa place.
L’Homme qui Baille a pris son temps et s’est enfin décidé à livrer ses secrets, le long de dix pistes évanescentes dans lesquelles vous vous laisserez couler, langoureusement, assaillis par un son que nul n’avait entendu depuis bien des années. Entre un psychédélisme venu tout droit des sixties, une touche de surf rock et des relents de peyotl, Yawning Man étale au sol une couverture mélodieuse, douce et moelleuse invitant l’auditeur à s’y allonger et profiter de ce moment de bonheur, démarrant sur un titre éponyme qui le plonge d’emblée dans un univers solitaire, emprunt de désolation mais respirant la liberté. "Perpetual Oyster" vous plonge dans une spirale vaporeuse, parfaite mise en abîme sonore de ce que peut être un voyage hallucinogène, les arpèges réverbérées de Gary Arce brodant leurs harmonies autour des lignes de basse lancinantes de Mario Lalli, se séparant pour mieux s‘enlacer et venir mourir ensemble au fond de notre crâne. Hernandez bat la mesure de sa frappe nerveuse mais réservée, cherchant à nous accompagner dans les volutes hypnotiques de ses comparses, lesquelles usent de motifs récurrents comme autant de lieux communs du désert californien, ce lieu où ils sont nés. Tombant parfois dans des registres plus sombres ("Advanced Darkness"), Rock Formations est avant tout une œuvre lumineuse, frappée par un soleil brulant qui se réfléchit sur le sable ("Split Tooth Under", "Crater Lake") et saura révéler ses vertus à l’auditeur posé, les yeux fermés, réprimant même un petit bâillement à l’occasion.
Rock Formations est tel un serpent, qui ondule sur le sable chaud et se love dans les coins de l’esprit réservés aux mélodies tortueuses et planantes, celles qui vous apaisent par leur légèreté et ne bouffent pas toute votre concentration. Pas vraiment un disque, en tout cas pas de ceux qui cherchent à laisser leur trace, juste un moment de repos pour trois mecs qui ont déjà bien vécu et se posent pour regarder leur monde, exprimant la puissante grandeur de leur liberté.
Geoffroy
Lire la chronique sur le site

avril 2006
Ce trio texan a quand même une drôle d’ambition : façonner un space-rock moderne qui fusionnerait les litanies répétitives du krautrock, la pompe flyodienne post-Barrett et une pop à la démesure des stades dans la droite lignée de… U2 ! La grande réussite de Ten Silver Drops, qui succède à un premier album prometteur (Now Here Is Nowhere, 2004), c’est que ça ne ressemble, au pire, que lointainement à cette mixture imbuvable que personne n’aurait envie de concocter. Qu’évoque la musique de ce groupe piloté par la fratrie Curtis (Brandon au chant, basse et claviers, Benjamin à la guitare et aux chœurs) ? Un Archive qui se regarderait moins le nombril, un Flaming Lips moins dispersé, un Mercury Rev plus frondeur, voire un Trail Of Dead adoptant une salvatrice concision dans les moyens adoptés pour faire planer son auditoire.
Dès l’introduction, magistrale, le cocktail marche. "Alone, Jealous and Stoned", où comment évoquer à la perfection son titre en tressant chagrin enveloppé d’une torpeur évanescente, résignation portée par une nuée de claviers élégiaques et abandon catapulté par de superbes chœurs en fin de piste. Dans le même registre, "I Want To Know If It’s Still Possible" rejoue avec bonheur les grandes ballades stellaires du Ziggy Stardust. La pop cosmique des Secret Machines procède ainsi d’une alchimie étrange, remarquablement évidente dans sa facture sombre et mélancolique, mais convoquant les nombreuses références qu’elle utilise de biais, fuyant au dernier moment le calque studieux. On y trouve du krautrock, certes, mais à dose homéopathique, seule la batterie répétitive de Josh Gorza officie franchement dans le domaine. Sur "Daddy’s In The Doldrums", morceau le plus long d’un album plutôt sobre pour les canons du genre (8 titres, 45 minutes), le but n’est pas de débiter un emboitement infini de boucles pour provoquer un état de transe, plutôt esquisser une marche robotique sur fond de guitares fuligineuses et de basses grondantes pour mieux glacer l’atmosphère, ou encore cracher son dépit à coups de claviers stridents ("I Hate Pretending"). Si Can il y a, c’est un Can vandalisé, maltraité, dégrossi, simplifié pour le faire rentrer dans un cadre pop. C’est là que Bono entre dans la danse, car quand le trio lâche la bride, c’est pour cavaler des refrains déployés avec emphase ("All At Once", "Lightning Blue Eyes"). Emphase, le mot est lâché. Une emphase qui ne vise pourtant pas à instituer la paix dans le monde par la simple autorité de sa suffisance, plutôt à bomber un torse gonflé à la testostérone juvénile, pas très loin des Who lorsqu’ils imposaient leur démesure dans leurs opéras rock. Un opéra rock, oui, mais sans histoire grotesque peuplée de personnages improbables. Un opéra spatial pour faire voyager l’esprit et magnifier l’amertume (car qu’en faire, sinon la transfigurer ?), à l’image du décollage progressif de "1000 seconds", qui ferme le disque dans le sillage de Pink Floyd tout en évitant l’abus d’effets spéciaux.
Prenant de bout en bout, Ten Silver Drops laissait imaginer un avenir radieux pour ses géniteurs. On pouvait clairement attendre par la suite un concept album poussant la formule dans ses retranchements. Mais Benjamin Curtis part rejoindre les School Of Seven Bells et laisse le groupe orphelin de cette alchimie qui nous faisait miroiter monts et merveilles. Les Secret Machines rejoignent donc la cohorte des formations qui auront gâché l’énorme potentiel qu’elles avaient laissé entrevoir. Les rouages de cette machine cosmique resteront donc un mystère. Tant pis, tant mieux.
Maxime