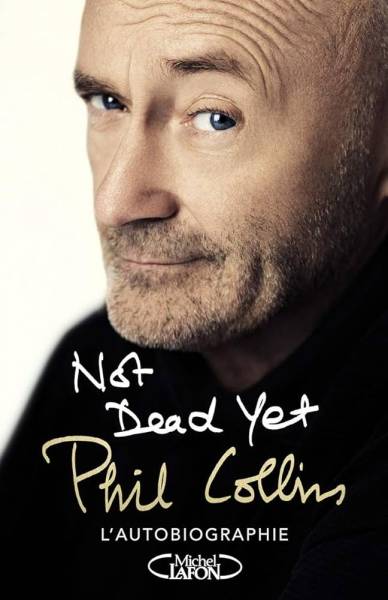Discorama 2000's : les incontournables pop
- Introduction
- 2000-2001
- 2002
- 2003-2004
- 2005-2007
- 2008-2009
2003-2004

février 2003
"Au génie !" a-t-on crié. Tel fut l’accueil, souvenez-vous, de cette surprenante artiste aussi inventive que touchante. Elle venait de se glisser, menue qu’elle était, au top des artistes prometteur de l’Hexagone. Un accueil favorable à tel point qu’on l’a rapidement encensée comme étant la Björk française. Comprenez : une artiste qui pose sa voix sur de la musique électro. Mais quelle voix ! Car au contraire de son homologue islandaise, Emilie Simon susurre, marmonne de sa voix douce et angélique. Un timbre enfantin qui donne toute sa dimension à une musique pop triturée et imagée, propice aux trips aériens. Et c’est vrai qu’en s’approchant un peu plus de ce qu’on peut déjà qualifier qualitativement d’œuvre, on se rend facilement compte que le monde d’Emilie Simon est beau, et qu’on souhaite s’y perdre.
Les quelques personnes qui en sont ressorties devaient être les mêmes qui lui ont décerné sa Victoire de la Musique, avant de replonger dedans par assuétude. Car on s’attache à cet univers, où tout appelle à l’évasion par le rêve, tantôt aidé par un violon ou un violoncelle, tantôt par une harpe onirique. Parfois, la belle brune complète elle-même ses palettes sonores de bruitages en tous genres, allant du craquement d’allumettes sur "Il pleut" aux nombreux recours à la table d’effet pour un véritable travail d’orfèvre. Les compositions en sortent à la fois délicates et complexes. Même la reprise étonnante des Stooges et de leur "I Wanna Be Your Dog" se retrouve considérablement assagie, mais jamais ennuyante, et contribue au mythe de la femme-enfant largement évoqué dans l’ensemble de l’album.
Avec ces sept années de recul, on apprend encore à apprécier cet album aux mélodies et aux instrumentations imparables, au dépend des disques qui ont suivi. Car la carrière de la Montpelliéraine, au fur et à mesure des productions, a laissé de côté de trip-hop glacial et merveilleux au profit d’une pop plus simpliste, avec moins de personnalité. Autant de raisons pour nous faire retourner vers ce premier opus, par une froide matinée d’hiver…
Geoffrey
lire la chronique de l'album

mars 2003
Difficile de faire l'impasse sur la Scandinavie quand on parle de pop, et difficile d'oublier les Cardigans dans ce créneau. Le groupe de Peter Svensson et de la belle Nina Persson, s'ils ont été les fers de lance de la pop rock suédoise dans les années 90 avec le tube "Lovefool" judicieusement placé dans la BO du Romeo + Juliette de Baz Luhrmann, sont restés pourtant assez discrets durant la dernière décennie. Ils n'en ont pas moins composé deux albums de très grande classe, Long Gone Before Daylight et Super Extra Gravity, entre 2003 et 2005, avant d'entamer une longue pause qui se poursuit toujours aujourd'hui. Et de ces deux albums, le premier garde encore à ce jour une grâce mélancolique assez remarquable.
Avant d'entamer l'écriture de ce disque, les Cardigans s'étaient déjà octroyés un hiatus de cinq ans pour digérer le succès planétaire de Gran Turismo, l'album de la consécration qui a propulsé les cinq suédois et leur rock soft et racé en tête des hits parades. Durant ce laps de temps, chaque membre alla vaquer à ses occupations, mais tous finirent par monter plusieurs side-projects : Peter Svensson et Bengt Lagerberg formèrent le groupe Paus (avec Joachim Berg de Kent), Magnus Sveningsson fit ses débuts en solo sous le nom de Righteous Boy, et Nina Persson s'associa à Mark Linkous (alias Sparklehorse) pour mener à bien le projet A Camp. Sur cet album, la chanteuse entreprit d'explorer un versant plus sombre de son songwriting tout en le parant d'arrangements doux tirant assez sensiblement sur la folk et la country américaine. Et lorsque revint le temps pour les cinq compères de retravailler ensemble, ils tombèrent d'accord pour ne pas surenchérir dans le style de Gran Turismo et pour exprimer une facette différente de leur musique, plus légère mais également plus noire. Noire comme la nouvelle couleur de cheveu de Nina, et ça n'est probablement pas le fruit du hasard.
Les premiers tours de platine de cet album s'avèrent déconcertants tant le fossé qui sépare les précédentes réalisations du groupe et celle-ci s'avère immense. Introduit par la jolie balade "Communication", Long Gone Before Daylight remise les amplis au placard et s'appuie sur un entrelacs d'arpèges acoustiques stylés et de coulées de guitares électriques fluides. Quelques exceptions existent pourtant, comme l'introduction pointue de "A Good Horse" qui laisse parler la poudre sans vergogne, ou encore les envolées du refrain puissant de "You're The Storm". Mais c'est vraiment la retenue et la pudeur qui transparaissent sur cet opus, sentiments magnifiés par les paroles introspectives de la miss Persson qui explorent avec brio les tourments de la psyché humaine. Et on ne pourra décemment rester de marbre devant un titre de la trempe de "And Then You Kissed Me", sublime mise à nu féminine rehaussée par un arrangement de cordes simple et merveilleux, ou encore "3.45 No Sleep" nous donnant envie de passer des nuits entières en douce compagnie. Ailleurs, "Couldn't Care Less" et "Lead Me Into The Night" se laissent bercer par un piano rassurant, tandis que "Please Sister" se laisse tenter par de jolis arrangements symphoniques. Mais les meilleurs titres du lot sont ces fameux morceaux pop-country, ces petits joyaux de songwriting doux-amers qui n'ont l'air de rien mais qui se font une joie de vous trotter dans la tête à longueur de journée. Parmi eux, le single "For What It's Worth" est probablement la plus brillante composition des Cardigans, emballé dans son arpège acoustique étonnant de simplicité entêtante et toujours admirablement déclamé par la voix douce et sensuelle de Nina Persson, ici au summum de ses effets sensitifs.
Voilà un album parfaitement ciselé, rigoureusement sous-estimé à sa sortie mais qui garde un supplément d'âme substantiel de nombreuses années après son arrivée dans les bacs. A consommer sans modération lorsque votre humeur se fait câline, sans oublier de vous attarder suffisamment sur l'opus suivant, Super Extra Gravity, plus tonique et presque aussi réussi que celui-ci. Mais quand diable les Cardigans vont-ils daigner sortir de nouveau de leur tanière pour nous réchauffer le cœur ?
Nicolas
lire la chronique de l'album

mai 2003
On avait quitté Blur à la fin des nineties sur un énième changement de masque. Après avoir été successivement émule crâneur des Stone Roses, héraut de la British way of life, grand rival de la confrérie Gallagher puis disciple turbulent du lo-fi américain, le groupe donnait à son étiquette britpop de grands coups de machette le long d’un 13 dépressif, aussi tortueux que délicat. La décennie suivante sera celle de Damon Albarn, fringuant quadra baguenaudant des Gorillaz à The Good, The Bad And The Queen avec flegme, multipliant les collaborations avec une habileté narquoise, furetant entre les genres avec une curiosité vorace. En ce début de millénaire, la station Blur n’émettra qu’une fois, délaissée par ses géniteurs pour une durée indéterminée. Quid de cette septième réalisation ?
Think Tank entérine la prise de contrôle totale du groupe par son chanteur. Déjà peu enthousiasmé par le virage stylistique amorcé par le collectif sur 13 et miné par sa dépendance à l’alcool, Graham Coxon, guitariste historique, est remercié au beau milieu des sessions d’enregistrement et part donner un élan déterminant à sa carrière solo. Albarn domine alors la formation de tout son poids. Ses récentes explorations (la mise sur orbite réussie de Gorillaz, l’expérience africaine de Mali Music) se répercutent fort logiquement sur cet opus. L’enregistrement est écartelé entre Londres et le Maroc, l’afrobeat tente une incursion dans le décor en briques rouges des Anglais. Les guitares couinent moins que les claviers bleapent, les beats cadencent tandis que la batterie s’efface, Fatboy Slim produit trois morceaux. Le titre Think Tank est ainsi à prendre au pied de la lettre : il s’agit littéralement d’un réservoir d’idées, un OuPoPo (Ouvroir de Pop Potentielle) ouvert aux mutations et aux hybridations de la génération haut débit. Chaque piste est une vignette différente de la précédente, elle ouvre une fenêtre sur un paysage nouveau. Conséquence directe : le disque revêt un aspect un peu éparpillé, fourre-tout. Pas plus au fond que les autres réalisations de Blur, lesquelles ont toujours préféré les ivresses de la fulgurance à la rigueur froide de l’homogénéité.
Sous sa pochette grisâtre, Think Tank prend donc les traits d’un kaléidoscope bariolé braquant ses rayons sur tous les continents. Les percussions et la basse gironde de "Moroccan Peoples Revolutionary Bowls Club" dialoguent ainsi avec le dub souffreteux de "Brothers And Sisters", "Jets" clôt ses pérégrinations cadencées sur un solo jazzy. Les Gorillaz restent les maîtres de la piste, et maintiennent boucles rythmiques et samples triturés au centre des attentions sur une bonne moitié du disque ("Ambulance", "Good Song", "On The Way To The Club", "Gene By Gene"). Albarn se promène avec aisance au milieu de cette jungle électronique, son timbre d’éternel bambin en bandoulière, et trousse de superbes ballades teintées d’amertume (formidable "Out Of Time", "Caravan", "Sweet Song"), consolidant un peu plus son statut de songwriter protéiforme et d’artisan pop multi-casquettes. Une telle soif d’aventure a cependant son revers de médaille, l’album donnant parfois l’impression de n’être rien d’autre qu’une très belle rédaction rendue par le premier de la classe. On devine parfois un peu trop la langue plissée de l’écolier déterminé à épater le professeur par ses trouvailles savantes, tout en prenant soin de chiquer au naturel. Think Tank exhale par intermittences un petit parfum commerce équitable, limite, autant lâcher le mot, bobo. Lorsque le trio monte le son des amplis pour muscler un peu l’ensemble, il sonne aussi artificiel et vain que Sonic Youth se mettant à jouer du Green Day. On n’y croit plus. Les "yeah yeah yeah !" goguenards de "Crazy Beat" (médiocre single) et l’expéditif "We’ve Got A File On You" n’égalent en rien le binaire déluré d’un "Song 2". La fougueuse adolescence des Londoniens semble s’être fait la malle avec Graham Coxon, lequel, bon prince, a glissé "Battery In Your Leg" sur le paillasson avant de partir, un morceau qui ferme le disque en adoptant la même démarche que ses géniteurs : claudicante et élégante.
S’il est loin d’être parfait de bout en bout (ce que n’a jamais été un album de Blur), Think Tank attrape toutefois l’auditeur avec facilité dans ses filets. Et transforme une intuition en certitude : le grand rival de ces types-là n’était pas Oasis mais Radiohead. Les deux combos sont gouvernés par une soif identique d’inconnu, de renouveau perpétuel et une appétence pour les bricolages stylistiques. A la différence de la bande d’Oxford, Blur préfère à l’expérimentation nombriliste l’exploration espiègle, celle qui laisse encore à l’enfance son droit de cité, état créatif singulier retrouvé et décliné à l’infini, dans lequel le jeu reste ouvert à tous les possibles. Versant humble du monolithe Kid A, Think Tank martèle l’idée d’une pop comme cure de jouvence perpétuelle.
Maxime
lire la chronique de l'album

juin 2003
Il aura donc fallu attendre quasiment trois ans et deux albums, Kid A et Amnesiac, pour que Radiohead réussisse enfin à digérer ses élans électro et se lasse de tous ces bidouillages froids. Annoncé pendant un temps comme un retour aux sonorités des débuts de l’aventure, Hail To The Thief apparaît rapidement comme tout sauf une violente marche arrière. Car si Thom Yorke et les siens se sont engouffrés aussi loin dans leurs méandres expérimentaux, il ne fallait pas non plus espérer que cela n’aurait pas de conséquence sur leur vision de la musique. Bien au contraire. Pour élaborer cet album, le gang d’Oxford s’est débarrassé de l’inutile pour ne conserver que ce qu’il a su faire de mieux depuis le début des années 90.
Ni rock, ni électro mais pas non plus vraiment pop, Hail To The Thief fait voler en éclats les genres musicaux bien définis et apparaît rapidement comme une des plus grandes réussites du groupe. Album aujourd’hui incontournable de ces dix dernières années, tous genres confondus, il n’est pas vraiment étonnant que certains considèrent encore aujourd’hui cet ouvrage comme un best-of rempli de titres inédits. Depuis OK Computer, le groupe n’avait jamais réussi à atteindre de nouveau une telle maturité musicale. Chaque instrument, chaque nappe d’électro, chaque égrènement de corde semble à sa place. Chaque montée en puissance est parfaitement maîtrisée ("Sit Down. Stand Up") et les ambiances vacillent et se renouvellent à chaque titre. Passant sans état d’âme d’une élucubration aux beats assumés ("The Gloaming") à une embardée pop enivrante de très haut niveau ("Go To Sleep"), dépoussiérant les touches d’un piano pour se lancer dans une complainte à l’impact calibré ("We Suck Young Blood") ou jouant la carte de la composition sans faille ("There, There"), le groupe fait de cet album un mille-feuilles sonore qu’aucune écoute massive ne pourrait ébranler tant la richesse et la profondeur de l’ouvrage s’avoue immense. Mais ce qui est encore mieux, c’est que Radiohead fait partie de ces groupes dont on ignore tout de la suite. Et rien ne nous dit que leur prochain album ne sera pas de nouveau une des meilleures productions de ces dix prochaines années.
Jérôme
lire la chronique de l'album

octobre 2003
Derrière une allure nonchalante, les Belges de Girls In Hawaii cachent une névrose esthétique tout à fait assumée. Si les mélodies et l'ambiance de ce premier album impriment une désinvolture adolescente, comme composée une bière sous le bras, entre amis et sur des routes ensoleillées, sachez qu'il n'en est rien. Il n'en est rien car chaque rythme, chaque instant est calculé, pesé, trituré et retravaillé jusqu'à atteindre l'harmonie souhaitée par les six musiciens belges. Rien n'est laissé au hasard, pas même l'illusion de la spontanéité et de la naïveté. Écouter From Here To There c'est sentir l'essence même de la pop, des ballades a priori sucrées et légères mais habitées sous la canopée de percussions facétieuses et de guitares qui s'emmêlent tortueusement. Un peu à l'image de jeunes Grandaddy des sous-bois, leur musique respire à pleins poumons une pop profonde et délicate. Sans jamais se frotter à la rigueur et la froideur du math-rock, ils distillent une musique lumineuse, parfois emmitouflée dans des nuages de coton et secouée par quelques rares orages électriques.
Chaque titre témoigne à sa façon cette bipolarité esthétique ; à la fois savante et nonchalamment jetée par dessus la jambe. "Casper", classique montée en puissance, voix filtrées et méli-mélo bourdonnant d'instruments, ou "The Fog", élégante dream-pop noisy, sont de ceux qui s'effeuillent un peu plus à chaque écoute. D'autres encore, parmi lesquels le single "Found In The Ground" s'apprivoisent au premier contact, telles des comptines pop habilement ficelées et immédiatement accrocheuses. L'album se veut divers, mais garde une homogénéité intacte grâce à une ambiance chaleureuse qui embaume l'ensemble des douze titres. From Here To There est un album duquel il est facile de passer à côté, mais non moins aisé d'y sombrer allègrement, passant subtilement d'ambiances atmosphériques ("Fontanelle") à des déluges de guitares maîtrisées ("Flavor"), avant de s'achever en douces balades pop : "Bees & Butterflies" et "Catwalk", pures et touchantes. Une réussite discrète, dans la longue lignée de celles qui ont fait de la pop un art majeur.
Les Girls In Hawaii ont donc été efficaces plutôt qu'originaux sur ce From Here To There. Surtout qu'à vingt-deux ans seulement de moyenne d'âge, les Belges ont surpris par leur maturité, leur perfectionnisme et plus encore par leurs performances scéniques de haute volée. Le second album sera dans la même veine, peut-être moins enchanteur mais tout aussi sophistiqué et mélancolique.
Kevin
lire la chronique de l'album

octobre 2003
Les dix années qui suivront ce fameux 30 juillet 2001 se sont apparemment évertuées à ne prouver qu’une chose : les Strokes n’avaient pour vocation qu’à être le groupe d’un seul album. Leur principale raison d’exister dans l’histoire du rock ? Réintroduire avec Is This It l’idée d’un binaire référencé, classieux, urbain, concis, retrouvant l’âpreté sensuelle des guitares, moderne dans sa coolitude, vintage dans ses fringues. Et après eux le déluge… Bombardé malgré lui résurrecteur d’un rock dont les amateurs n’avaient jamais diagnostiqué le trépas (tout au plus une relative baisse de forme face l’avènement populaire de la techno), le combo new-yorkais fait songer à ces insectes mâles dont le destin est de mourir quelques heures après avoir fécondé la femelle. Poussé à son corps défendant par la presse à tenir un rôle de vigile qu’il n’avait jamais revendiqué, on attendait de lui qu’après avoir mis un pied dans la chambranle, il illumine la décennie à coups d’albums visionnaires et de slogans définitifs que reprendrait en chœur la génération MySpace. Il n’en sera rien. Ouvrant de longues années de redites, rancœurs et autres rendez-vous manqués, Is This It ne restera qu’un disque symptôme, condamné à rester figé en image d’Epinal de l’histoire du rock, chapitre "revival du début des années 2000". Vitrifiés par leur hold-up médiatique, les Strokes étaient déjà de l’histoire ancienne dès 2003.
La grande logique aurait voulu que Julian Casablancas et ses potes transforment l’essai par un disque dépassant en tous points Is This It. Ce toujours difficile deuxième album aurait dû se révéler prophétique, miraculeux, indépassable. Il se devait d’être une référence indiscutable qui dicterait au troupeau la marche à suivre, bref d’emboîter nonchalamment le pas à Nevermind et Ok Computer. La genèse de ce second opus tant attendu va dans ce sens puisque la troupe réquisitionne les services de Nigel Godrich, le Phil Spector contemporain et fameux sixième membre de Radiohead selon l’expression consacrée. Manifestement, on a voulu tailler un costard trop grand aux Strokes, celui de génies universels, alors qu’ils sont visiblement plus à l’aise dans les entournures slim de leur garage-pop convulsif taillé exactement à leur modeste envergure de jeunes gens doués bien décidés à ne pas forcer leur talent. Après plusieurs sessions stériles, Godrich est remercié pour laisser place à leur vieux complice Gordon Raphael.
Eberluée, la planète rock voit donc débarquer à l’automne 2003 un Room On Fire qui n’a d’incendiaire que le titre, succédant placidement à son prédécesseur, sans volonté affichée de lui faire de l’ombre. Partout on crie à la redite, à l’auto-plagiat frileux. Pourtant, le groupe a consenti à entreprendre les aménagements nécessaires. Il quitte l’axe Velvet Underground/Iggy Pop/Modern Lovers pour s’inscrire dans le sillage de formations avec lesquelles il partage finalement davantage d’affinités, Cars, XTC et Blondie en tête, autrement dit ces combos à la charnière entre deux époques, la fin rebelle des seventies et le lustre kitsch des eighties naissantes. Cet opus, le cul coincé entre les relents nicotiniques du CBGB et la grâce plastoc de la New Wave, a valeur de manifeste esthétique, délivrant un rétro-futurisme aussi suranné que les décors d’Orange Mécanique. A l’exception du micro saturé de Casablancas, les tics minimalistes disparaissent du paysage, la production renonce quasiment à tout grain artificiel, la basse ronronne enfin de tout son poids replet. Room On Fire n’offre ainsi pas plus que ce que Is This It proposait : 11 titres nerveux ou boudeurs qui s’appréhendent dès le premier passage, plaisants et accrocheurs. Le grand mérite des Strokes reste avant tout d’avoir remis au goût du jour le format pop des mid sixties, soit une grosse demi-heure de musique qui ne s’essouffle jamais et ne se perd pas en divagations superflues. On tourne enfin la page des années 90, lesquelles, avènement du CD oblige, s’étaient entêtées à livrer des brouets indigestes de 15-16 plages farcis de morceaux bouche-trous et de ghost tracks inutiles pour combler ces satanées 80 minutes d’espace disponible. A bien y regarder, rares sont les groupes qui brilleront sur ce format à la suite des new-yorkais : Franz Ferdinand, Kings Of Leon (à leurs débuts), Arctic Monkeys, Weezer jusqu’en 2003. Et puis qui ?
Délivré de l’effet de surprise, le quintette brille enfin de sa force sereine. Sans avoir l’air d’y toucher, il dégaine une belle collection de tubes aux refrains maussades ("12 :51"), nasillards ("The End Has No End") et urgents ("Reptilia"). Délaissant les clichés frelatés du garage-punk new-yorkais pour n’en conserver que l’énergie, toujours foncièrement old-scool dans sa rectitude, le groupe déambule avec un chic affecté entre power-pop morveuse ("Meet Me In The Bathroom", "I Can’t Win") et rengaines narquoises ("Automatic Stop", "Under Control"). Le but reste inchangé : enquiller une petite dizaine de morceaux qui retrouveraient l’équilibre magique d’un "Paperback Writer", d’un "Midnight To Six" ou d’un "Ever Fallen In Love". C’était un peu perdu d’avance, mais l’intention reste louable, surtout que le groupe se montre à nouveau d’une cohésion à toute épreuve. Les guitaristes Albert Hammond Jr. et Nick Valensi se lancent dans des duels stéréophoniques comme dans les grandes heures de Television, tandis que Nikolai Fraiture compte les points en admonestant un éboulis de grooves dont le minimalisme rejoint les frontières de l’autisme. L’un mouline en mâchouillant son chewing-gum tandis que l’autre sabre en plissant son visage de petit minet. Les riffs dialoguent avec élégance, quadrillent l’espace en abscisses et ordonnées punky-pop, débitent des gimmick astucieux (la ligne de guitare doublant le couplet de "12 :51", l’intro de "The End Has No End"), couinent dans les breaks ("Reptilia"), taraudent sur la rythmique avec une morgue robotique ("Automatic Stop", "Meet Me In The Bathroom"), jaillissent avec avidité dès que la machine s’emballe ("The Way It Is"). Un véritable ping-pong guitaristique, aussi vif et intense qu’insolent tant il ne respire jamais le labeur ni la démonstration stérile. Les Strokes restent plus jamais à des lieues de la concurrence.
Pendant que ses potes déroulent le programme avec application, Julian Casablancas reste fidèle à lui-même, geignant les mâchoires serrées, manifestement toujours gêné d’être là, rejetant le CDD au poste de rock star générationnelle d’un air las. Tournant les talons à cette mascarade, le bonhomme préfère trousser quelques rimes chétives narrant sa récente rupture amoureuse. Mais rien ne nous empêche de leur trouver un sens caché. Que comprendre, lorsque les premiers mots qui ouvrent l’album sont les pléonastiques "Je veux être oublié, et je ne veux pas qu’on se souvienne de moi" ? Une déclaration d’intention destinée à calmer tout le monde. Room On Fire ne sera pas un signe de renouveau, il montre au contraire des Strokes résolus à retourner vers l’ombre de leurs débuts, souhaitant redevenir des soldats anonymes de la cause. Face à la décennie qui s’installe et qui sera encadrée par les attentats du World Trade Center et la crise économique (deux catastrophes dont l’Amérique est à la fois le coupable et la victime), Casablancas aligne sa position sur celle des futurs MGMT et Late Of The Pier : haussement d’épaules généralisé, circulez y’a rien à voir. Que dire face à ce monde flou, cette époque molle, fatiguée mais qui ne s’embrase jamais, quand il n’y a pas d’ennemi défini mais une invisible chaîne de micro-renoncements qui nous rendent tous un peu co-responsables ? Répondre par une colère larvée aux frontières de l’apathie. Incommunicabilité ("Automatic Stop"), recherche de substituts à l’ennui ("Reptilia") et résignation ("You Talk Way Too Much", "I Can’t Win") dominent les débats. Le constat de la jeunesse des années 2000 est clair du côté Casablancas : "Je ne veux pas changer ton esprit, je ne veux pas changer le monde, on est jeunes mais on est sous contrôle." Un bilan désabusé finalement bien plus violent dans son amertume que n’importe quelle diatribe fracassante.
Pourquoi alors sacrifier tant d’énergie à évoquer ce Room On Fire, disque déterminé de la première à la dernière seconde à ne pas sortir du rang ? Parce qu’il est le dernier témoignage discographique de ce que les Strokes auraient toujours dû rester. Un groupe de power-pop qui, dans la lignée des Cars ou des Replacements, aurait aligné 4-5 disques formellement modestes et mélodiquement entêtants avant d’arrêter l’affaire sur une chaleureuse poignée de main, le sentiment du devoir accompli. Au lieu de quoi on les a forcés à enregistrer ce satané grand album, qui ne fut pas Room On Fire mais son successeur, First Impressions Of Earth. Surgonflé par une production obèse, le disque fit illusion lors des premiers tours de piste avant de prendre rapidement la poussière. Depuis, chacun papillonne en solo. Albert Hammond Jr. se révèle être un petit songwriter doué tandis que Casablancas s’obstine dans son trip eighties. Pourtant, tout le monde s’acharne à les voir réunis à nouveau, alors que les musiciens n’ont visiblement plus envie de jouer ensemble. Qu’attendre d’un quatrième album dont la gestation s’est déroulée dans une ambiance qu’on qualifiera pudiquement de délétère ? Tandis que la multitude se précipitera sur cette déception annoncée, on préfèrera écouter, toujours et encore, ce Room On Fire, humble post scriptum de cinq types très doués et un peu désenchantés.
Maxime
lire la chronique de l'album