
Discorama 2000's : les incontournables hard rock/metal
- Introduction
- 2000-2001
- 2002-2004
- 2005-2006
- 2007-2009
2000-2001
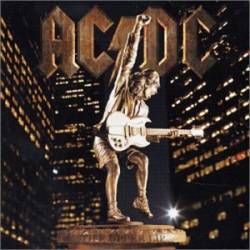
février 2000
Faire le tour de la décennie musicale du côté hard rock sans parler des cadors indéboulonnables et leaders incontestables du genre paraît aussi improbable qu'inimaginable. Même si les sorties du groupe se font de plus en plus rares, même si dorénavant leur unique occupation semble être de remplir des stades les uns derrières les autres, autant se replonger directement aux balbutiements des années 2000, date de la sortie du quinzième album des australiens, à une époque ou Internet n'avait pas encore envahi notre espace vital et que la seule et unique chance d'avoir un aperçu de ce Stiff Upper Lip était de traverser la bande FM jusqu'à tomber sur une émission animée par Zegut et d'attendre qu'il sorte ses enregistrements de "Safe In New York City" pompées sur un vieux magnétophone. Et à l'heure de coucher ces lignes, non sans nostalgie, on se remémorera de cette soirée, quelques heures avant la sortie mondiale de l'album, où notre Tonton préféré nous faisait écouter tout cela avant l'heure. Et huit fois d'affilé. Le genre de soirée qui ne risque plus de se reproduire de sitôt mais qui laisse un souvenir impérissable.
Epaulé par le grand frère Young à la production (George) en lieu et place de Rick Rubin remercié après le controversé Ballbreaker, Stiff Upper Lip laisse éclater au grand jour ce que tout le monde savait déjà. La musique d'AC/DC prend sa source dans le blues le plus primaire et les grands pères comptent bien enfin se faire plaisir sans se sentir obligés de ressasser leur sempiternel hard-boogie. Et cet album est une franche réussite, n'en déplaise aux fans de la première heure, qui s'empressèrent de vendre la peau des Boyz, jugeant les douze titres indignent et mollassons sans se rendre forcément compte de la richesse de l'ouvrage.
S'ouvrant sur le désormais mythique "Stiff Upper Lip", les deux frangins semblent prendre un malin plaisir à dérouler des riffs et des rythmiques sobres et efficaces. Preuve en est le groovy "Meltdown", avec ses guitares sautillantes sous les coups de baguettes bien appuyées de Phill Rudd, "House Of Jazz" et son tempo ralenti aux faux airs de blues sinueux débouchant sur une montée en puissance plus traditionnelle ou encore "Satellite Blues" sonnant comme un classique du genre dès son premier passage. "Can't Stand Still" reprend un peu les choses là ou "The Razor's Edge" les avaient laissées en laissant le soin à Malcolm de s'occuper du solo alors que "Can't Stop Rock' N' Roll", "Damned" et "All Screwed Up" s'avèrent aussi fédérateurs que poussiéreux et burinés par le soleil. Rien ne sert de s'exciter car au final le métronome ne décolle que rarement, osant une petite accélération pour l'autre tube de l'album qu'est "Safe In New York City" ou pour clôturer comme il se doit ce Stiff Upper Lip avec "Give It Up", sonnant comme du AC/DC première jeunesse.
Avec un peu de recul, on se rend compte qu'à travers cet album il n'a jamais été question de donner leur ration de hard aux hordes de fans du groupe. Après vingt-sept ans de bons et loyaux services, le combo australien s'est enfin décidé à faire un disque à son image en sortant un des albums les plus matures de sa carrière. Certes, on reste loin des monuments que peuvent être Highway To Hell ou Back In Black, mais Stiff Upper Lip soutient largement la comparaison face au reste de la discographie. De toute façon, un album moyen d'AC/DC sonnera toujours mieux que la meilleure production de n'importe lequel des jeunes loups actuels. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont dans ce business depuis tout ce temps.
Jérôme
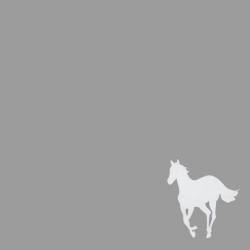
juin 2000
C’était il y a pile 10 ans, mais cela semble remonter aujourd’hui à une époque tellement plus lointaine. Il faut pourtant s’en souvenir : en ce début de millénaire, le vocable metal ne s’employait qu’accolé au préfixe neo (ou nü). Partout sur la planète, les décibels plombés ne se pratiquaient qu’en Ibanez 7-cordes et en Van’s, le baggy serré au ras des fesses avec l’indispensable chaîne reliant la ceinture à la poche avant. Korn, Limp Bizkit et Incubus dominaient les charts, rejoints par une engeance rapidement parvenue sous le feux des projecteurs, Linkin Park, Papa Roach et Slipknot en tête, mais aussi une kyrielle de combos tous plus accablants les uns que les autres (Crasy Town, Disturbed… rien que l’évocation de leur souvenir fait trembler l’échine). Que retenir de toute cette vague ? Pas grand-chose, et la relative discrétion du nu-metal dans ce discorama en est bien l’illustration, tant il est vrai que le peu que ce mouvement avait à dire, il l’avait déjà bien postillonné dans les années 90 avec ses disques séminaux.
Les âmes charitables qui auront la miséricorde de retenir une poignée d’albums parmi toute cette flopée de post-ados hurleurs proprement tatoués n’oublieront évidemment pas Deftones et son troisième opus. Car le quintet de Sacramento mérite tellement plus que le purgatoire dans lequel se sont vus jetés nombre de ses immondes collègues. On a toujours été tenté de réfuter l’appartenance du groupe au nü-metal, sans doute pour éviter qu’il soit sali par la médiocrité de ses comparses. Pourtant, tout comme ses camarades, Deftones n’est qu’une bande de white trash californiens qui ont longtemps fantasmé sur le hip-hop scandant le quotidien du quartier noir à quelques blocs de chez eux, sans pour autant jamais perdre de vue les guitares viriles d’un Metallica et l’œcuménisme forcené d’un Rage Against The Machine. Mais dès que Korn se mettra à lancer le mouvement au milieu des années 90, il se contentera de l’accompagner de loin, le regard de biais. Le combo de Chino Moreno transcendera le genre à sa juste place, en outsider.
Le temps de deux albums rageurs, Deftones était vite apparu comme un des fers de lance de cette nu-school. Mais on sentait, à écouter la voix de Moreno flotter sur "Be Quiet And Drive" ou psalmodier sous le soleil écrasant de "My Own Summer", que le combo en avait plus sous la semelle qu’un énième pourvoyeur de bande-son pour vidéos de skate. Ainsi, White Pony est sans doute la tentative la plus aboutie par un groupe de néo-metal de s’affranchir des codes du genre. Et cette réussite prend sa source dans un conflit qui minera longtemps l’enregistrement de l’album, lequel s’étalera sur plus d’un an. Fan de Depeche Mode et de The Cure, Chino Moreno veut amener ses influences new wave et électro dans le groupe, tandis que Stephen Carpenter, massif guitariste astreint par un régime strict à base de burritos, entend persister sur les voies du metal, fusse-t-il niou. Le producteur Terry Date, au chevet des boys depuis leurs débuts, impose finalement un compromis entre ces deux orientations. La grâce de White Pony provient vraisemblablement de ses origines contrariées. Pour la première fois, Deftones engendre de véritables mélodies, et non plus une alternance poussive entre couplets susurrés et refrains hurlés comme un goret sur la chaîne d’équarrissage. Les impériaux "Digital Bath", "RX Queen" et "Change (In The House Of Flies)" naviguent ainsi en eaux troubles, aussi cotonneux que fébriles. Ils ont le pouvoir attractif des néons des parkings mall qui attirent les phalènes vers leurs lueurs gazeuses.
Si la figure du poney blanc est pour le groupe une allusion à la cocaïne ou à une image subliminale qui frapperait les rêves post-coïtaux, on pense bien évidemment au lapin blanc d’Alice au pays des merveilles, à cette créature assurant le passage entre deux mondes. Ici, le quintet absorbe l’auditeur dans une enveloppe aqueuse pour l’inviter à contempler les replis des grandes cités américaines baignées par le crépuscule. White Pony ne fait qu’évoquer piscines désertes, périphériques silencieux, collines perchées sur la banlieue endormie, passé à observer d’un air béat les immenses amas de béton criblés de lumières vives. Apparu timidement au détour d’Around The Fur, le DJ Frank Delgado impose de plus en plus sa marque. Le vaporeux "Teenager" déploie sa mélancolie lasse sur des samples de piano crépitants, "Feiticeira" ouvre ses bras et ferme ses poings sous des nuées d’échos tremblotant dans l’atmosphère. Face à ces climats en demi-teinte où la torpeur latente est parfaitement canalisée et retranscrite, les décharges d’électricité pure n’en apparaissent que plus violentes. "Elite", "Street Carp" et "Korea" sont des montées d’adrénaline grisantes, des éclairs fulgurants tonnant sous un ciel serein. Il faut à nouveau louer les talents d’Abe Cunningham et sa batterie syncopée au son parfait, les riffs de Stephen Carpenter bouillonnant dans la distorsion, la basse de Chi Cheng, ferme et douillette à la fois. Ils portent à l’excellence les longs "Passenger" (sur lequel Maynard Keenan fait une apparition) et "Pink Maggit".
Réconciliant un genre bâti sur l’adolescence éphémère avec la sagacité de la maturité, White Pony est peut-être la seule amorce de passage à l’âge adulte réussie par un groupe de néo-metal. Le public suit, même s’il faudra notamment pour cela enregistrer une version hip-hop de "Pink Maggit", "Back To School", laquelle se verra très justement reniée par le quintet. Les Californiens se contenteront ensuite de prospérer avec plus ou moins de réussite sur les bases de ce troisième opus sans avoir encore jamais tout à fait retrouvé cet équilibre impeccable entre rage et suavité. Mais le coup de force est suffisamment considérable pour que, alors que le théâtre pédophilo-morbide de Korn en a lassé plus d’un depuis plusieurs années, on se mette toujours à attendre le dernier Deftones avec la même ferveur.
Maxime
lire la chronique de l'album

avril 2001
Rammstein n’a certainement pas inventé la poudre, ni le metal industriel. Et quand on y songe, Trent Reznor a produit des sons tellement plus puissants que cela en est humiliant pour les teutons. Mais, car il y a toujours un mais, les Allemands ont un don certain pour assembler tous les ingrédients de la réussite musicale. La force du groupe est de proposer un phénomène total : musique martiale, image sulfureuse, langue allemande. Et là-dessus il n’y a pas de doute, Mutter est leur chef-d’œuvre. Le fan de la première heure vous dira que Herzeleid et Sehnsucht étaient plus brutaux, plus authentiques. Rien n’y fait rien, Mutter est l’album de la consécration. Impossible de résister aux violons de "Mein Herz Brennt", de ne pas lever la main sur "Ich Will" ou de verser une larme pour la mère de Till, sur "Mutter". Car, Rammstein sait comme personne construire des hymnes metal, alliant tranchant des guitares et mélodies.
Il faut bien le confesser, le plus de la formule Rammstein c’est l’exotisme. Personne depuis Nenna ne s’était essayé à exporter un titre en allemand, pourtant ça marche. Très bien même. Quant à la qualité intrinsèque de l’album, elle peut être discutable sur des pistes comme "Rein/Raus" ou "Nebel", mais le mythe est si puissant- et justifié- qu’il serait difficile de le critiquer. Surtout que presque dix ans après sa sortie l’écoute de l’album provoque encore une intense chair de poule.
Pierre
lire la chronique de l'album

avril 2001
L’avantage de ce vaste territoire imaginaire que constitue la musique, c’est que l’on peut totalement ré-inventer sa propre identité au mépris de toute réalité temporelle et géographique. Nul besoin d’avoir connu le Swinging London pour marcher sur les pas glorieux des Kinks, tout brevet d’ouvrier sidérurgique de Detroit est superflu quand on prétend pratiquer du garage rock à son stade primal, inutile de venir des bas fonds de New-York ou de Londres pour succomber à la rage punk… Ainsi, il serait malvenu de toiser d’un œil mauvais ce quartet issu de Toledo, Ohio, quand il entend secouer l’idiome blues avec la nonchalance sudiste d’un Lynryrd Skynyrd et la puissance de feu du stoner. Après tout, les excellents Creedence Clearwater Revival avaient brillamment prouvé des décennies avant eux qu’il n’était pas obligatoire de venir du bayou pour porter au pinacle blues suintant et country baveuse. Car près de 15 ans après leurs premiers faits d’armes, un constat s’impose : la plus parfaite synthèse entre heavy rock testostéroné et swamp blues gluant n’a pas été réalisée par des natifs de Palm Springs ou de la Nouvelle-Orléans, mais bel et bien par des petits gars du nord du continent.
Tout aussi illégitimes soient-ils de par leur sang, les Five Horse Johnson en imposent à qui veut l’entendre dès que l’on branche les amplis. Sur une colonne vertébrale résolument blues qu’ils consolident de disques en disques (leur premier album, Blues For Henry, a été enregistré dans un des berceaux du bluegrass), les artilleurs greffent les éléments types du heavy rock burné : des riffs graisseux dérivant entre cataractes de power chords adipeuses et grandes rasades de slide poisseuse, une section rythmique imparable et le chant de ce grand gaillard blond d’Eric Oblander, dont l’organe enroué baignant dans un mélange de Budweiser et de Jack Daniel’s sied parfaitement à ce genre d’exercice. Conjuguant la fougue âpre d’un Karma To Burn avec la finesse rustre d’un Clutch (les gaillards auront la bonne idée d’emprunter le batteur du gang du Maryland, Jean-Paul Gaster, le temps d’un disque et de quelques tournées), le quintet peut s’enorgueillir d’une discographie sans faille où il fait revivre avec bonheur une certaine idée du rock tel que pratiqué dans le deep south des seventies. Juste à titre d’exemple, voici peut-être la meilleure chanson de ZZ Top écrite par un autre groupe que ZZ Top.
N°6 Dance, leur troisième opus, reste leur réalisation la plus aboutie. La question des origines est abordée d’emblée le temps d’une intro ironique. Un dialogue semblant tiré d’un western s’engage : "- Where are you from, maverick? – I’m from Ohio, sir. – Are you born there? –Yes, sir. –What about Toledo?" L’imposant "Mississippi King" tonne alors comme une braillarde réponse, une remarquable charge de binaire massif, aussi vaseuse, menaçante et irrésistible qu’un fleuve en crue. Une fois leur style solidement amarré, les Five Horse Johnson ne dévieront plus de leur cap, avec la même authenticité que leurs cousins germains de Black Keys, juste la barbe un peu plus fournie, la chemise de bûcheron un peu plus huileuse sous les aisselles et la guitare marinant davantage son jus du côté des Allman Brothers que de Howlin’ Wolf. Pour le reste, The N°6 Dance aligne une réjouissante alternance entre rock bourru pourtant pas avare de subtilités ("Spittin’ Fire", "Gods Of Demolition"), boogie marécageux ("Shine Around", "Swallow The World") et binaire tanguant comme un hillbilly enivré par son propre whisky distillé dans sa baraque miteuse ("Lollipop", "Buzzard Luck"). Eric Oblander cède le micro de temps à autres à son comparse Brad Coffin, le temps pour lui de plonger dans son impressionnante collection d’harmonicas pour venir tonner de concert avec ses camardes sous les atmosphères chaleureuses d’un southern rock aussi moite que jubilatoire ("Silver", "Swallow The World"). Ailleurs, la bande prend un malin plaisir à dévergonder les Three Dog Night le temps d’une reprise endiablée ("It Ain’t Easy"). Ultime baroud d’honneur, le copieux "Odella" final, marche pesante et hypnotique de plus 14 minutes, sonne une migration entamée depuis les berges de la Louisiane vers les plaines lysergiques de San Francisco, trainant derrière elle des relents de poudre de Winchester et de buvards de LSD.
A travers Five Horse Johnson, c’est aussi leur label qu’on tient à saluer, le bien aimé Small Stone Records. Le travail acharné de son fondateur, Scott Hamilton, mérité tous les éloges. Si une bonne partie des mercenaires qu’il a signés tourne autour de la formule heavy/southern/stoner rock telle qu’érigée par la tête de proue de son catalogue (Dixie Witch, The Brought Law, Throttlerod), Hamilton n’a pas son pareil pour faire varier les plaisirs. Quelque soit la sauce à laquelle vous dégustez votre heavy rock, Scotty a le groupe qu’il vous faut. Voici une poignée de noms qui se sont illustrés dans cette décennie pour vous mettre en appétit : stoner méchamment burné (Solace, Halway To Gone, Red Giant, The Glasspack), high volume rock trippant (Iota, Acid King), krautrock pachydermique (Giant Brain), doom stratosphérique (Ironweed, Los Natas), stoner massif (Novadriver, Sasquatch, House Of Broken Promises, Dozer)…
Maxime

mai 2001
"We’ll ride the spiral to the end and may just go where no one’s been"… Cette phrase, point d’orgue de "Lateralis", est certainement la maxime qui résumerait le mieux la musique de Tool. Une spirale hypnotique, brisant les frontières tout en conservant un charme prophétique et divin. Un hommage passionnel à tous les sens fondu dans une œuvre complexe mais accessible, dans la profondeur d’un mysticisme saturé repoussant les limites de la composition et de la compréhension jusqu’à se transcender et se libérer, oublier le corps au profit de l‘esprit.
"Praying open my third eye" hurlait Maynard James Keenan dans les derniers instants de Aenima. Il lui aura fallu cinq années pour y parvenir, remontant le flux des émotions, se débarrassant de son enveloppe charnelle pour atteindre l’omniscience au fil d’un album à la richesse incommensurable qui ne peut être écouté avec distraction. Lateralus est un bonheur égoïste, un moment de grâce qui ne se partage pas et puise sa force dans les sentiments qu’il fait naitre en soi, créant un cycle infini emprunt de violence, de fragilité, de passion et d’abandon. Plus qu’une ode à la vie, il est l’essence de la vie dans la contemplation de ce qui la compose, se nourrit de tout sentiment qu'il soit sombre ou lumineux, utilisant la colère comme un vecteur de positivité.
Rarement une musique n’avait touché de si près à la synesthésie, évoquant autant de sons que de visions, encens et textures dans des structures à couper le souffle et une atmosphère spirituelle tellement intense qu'elle en dépasse la notion humaine. Entre une guitare à l’inventivité aussi poussée que son minimalisme, une basse qui se libère totalement des carcans rythmiques pour se concentrer sur la mélodie, une batterie foudroyante de technique et de symétrie et la luxuriance d’un chant incantatoire, suave et envoutant, capable de faire surgir la vérité des recoins les plus cachés de l’âme, Tool ne se pliera jamais à aucune étiquette réductrice, explorant autant de facettes de l’être qu'il existe d‘harmonies et de dissonances.
Lateralus est l’expression ultime d’une philosophie qui ne mentira jamais son propos, soutenue par une idée de l’esthétisme complète et fascinante. L’intelligence artistique atteignant son paroxysme mais toujours en constante évolution. Avec cet album, Tool révolutionne la musique saturée en lui conférant un degré de spiritualité jamais atteint ; une pièce maitresse de cette dernière décennie.
Geoffroy
Lire la chronique sur le site
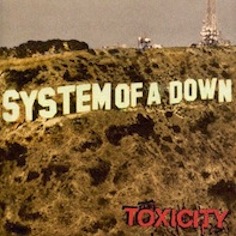
septembre 2001
Deuxième album de System Of A Down, Toxicity est également celui qui les révéla au grand public. Avant cela, les quatre américano-arméniens avait pondu un premier opus éponyme au succès certain dans certaines sphères. Et déjà, le groupe imposait des textes engagés et rageurs à l'encontre du système américain. Avec Toxicity, Daron Malakian, fondateur du groupe, et Serj Tankian, chanteur, impose un nouveau son au pays du métal. D'abord, il y a ces coupures de rythme, ces changements brutaux au sein d'un même titre qui perdent les habitués du déferlement perpétuel de sons matraqués. Malakian et Tankian aiment surprendre et n'hésitent pas dès "Prison Song" à afficher clairement leur différence. L'ouverture commence avec suspense, se poursuit sur un rythme effréné et s'interrompt brutalement pour laisser place à un pont sautillant et complètement barré. Et c'est ce décalage perpétuel entre son et paroles, ce sentiment de trip entre potes sur des compos pourtant incroyables, qui donne tout son attrait aux compositions de System Of A Down. D'autant que la voix de Serj Tankian renforce encore ce sentiment. L'homme peut se permettre toutes les singeries vocales, ses capacités sont impressionnantes, et particulier celle qui lui permet d'être juste dans les envolées les plus bizarres.
Et si Toxicity a tant marqué son époque, c'est que System Of A Down a ouvert le métal à un nouveau public. Son mélange des genres, cette capacité à marquer des pauses sans paraître lâcher du lest leur permet de garder un auditorat métal, tout en séduisant les amateurs de rock conventionnels. Evidemment, le groupe fait des ravages dans les populations adolescentes, mais pas seulement. Le génie de Malakian, Tankian, Odadjan et Dolmayan séduit également les puristes, qui ne résistent pas à des titres comme "Aerials", quand les plus jeunes s'éclatent dans leur chambre sur "Chop Suey". System Of A Down semble pouvoir tout se permettre, des choeurs sur des basses lourdes aux contre-chants dopés à l'hélium en passant par les ponts tendance "trip chez les indiens". Les deux gros singles de l'album restent "Chop Suey" et "Toxicity", deux titres construits avec deux thèmes qui s'alternent, l'un effréné, l'autre faisant la part-belle aux envolées vocales de Tankian,
System Of A Down a ainsi toujours su se singulariser, sans pour autant donner l'impression de le chercher. Les roulements de "r" de Tankian (ici particulièrement sur "ATWA") deviennent une marque de fabrique, tout comme l'utilisation fréquente de "lalala" et autres onomatopées. Mais SOAD doit également sa renommée à ses textes, engagés, contestataires, particulièrement contre les injustices du système américain, que ce soit la santé ou l'économie. Si les métalleux ne se privent pas non plus de parler de sexe, leur écriture les a rangé dans les plus intellectuels du milieu. Preuve qu'on peut réussir des compos qui ont du sens sans se poser sur trois accords de guitare sèche. SOAD a réconcilié le public une certaine idée du métal commercial de qualité, offrant à la fois un son impeccable et nouveau, et des textes qui tiennent la route. L'album a marqué sa décennie, et depuis, SOAD n'a pas vraiment fait mieux.
Elise
lire la chronique de l'album







