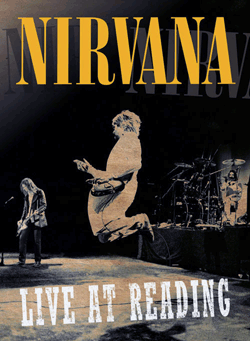"Le meilleur live de tous les temps ? A voir."
Nicolas, le 05/04/2013
( mots)
Ah, le Live At Reading... Cela faisait un peu plus de quinze ans que les adorateurs du grand Kurt piaffaient de pouvoir mettre la main sur le plus grand concert jamais donné par Nirvana et dont les bootlegs s’échangeaient par camions entiers dans les circuits parallèles. Ceux qui se sont déjà intéressés à l’engin savent que ce DVD et le disque qui en est issu se sont fait encenser de façon déraisonnable par une presse spécialisée désormais totalement asservie au défunt petit blondinet aboyeur à gueule d’ange. Soit, mais un son de cloche un rien moins enthousiaste peut tout autant se concevoir, n’est-ce pas ?
Le fait est que, malgré son statut culte parmi les groupe cultes, malgré l’impact démesuré qu’a opéré le trio d’Aberdeen sur la musique mondiale au cours des années 90, malgré les millions de T-Shirts arborant la face inexpressive et le regard intense du grand Cobain, Nirvana n’a jamais été un groupe extraordinaire en live. Quoi quoi quoi, qu’est-ce qu’il raconte, ce freluquet ? Mais faites-le donc taire ! Manque de bol, vous ne pouvez pas me faire taire, et je vais donc poursuivre. Quand on vient voir du rock en concert, on s’attend à du son, du spectacle, de l’énergie, de la présence scénique, du partage, voire de la magie. Nirvana ne possède que l’énergie, et encore par intermittence. Des approximations hasardeuses à la guitare et au chant (Kurt, si tu nous écoutes), une implication en dent de scie, une communication proche du néant, un spectacle scénique parfois abscons... mais d’excellentes chansons, un leader imprévisible et un putain de batteur. C’est ça, Nirvana en live. Après, Reading constitue certainement, et de loin, la meilleure prestation des trois pieds nickelés, mais de là à ériger l’événement comme "le plus grand concert rock de tous les temps", faudrait peut-être voir à arrêter de déconner, quand même.
Le 30 août 1992, Nirvana se retrouve en tête d’affiche pour la clôture du festival anglais de Reading. Tout le terrain a été défriché pour que le venue des trois punks américains soit un succès, la grande scène a été aménagée spécialement pour eux, et les compatriotes de Seattle sont de la partie tout au long de l’après-midi (Mudhoney, Screaming Trees, The Melvins). Encore faut-il que Nirvana soit dans un grand jour, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est loin d’être gagné d’avance. Deux semaines avant l’événement, Kurt célèbre la naissance de sa fille Frances Bean en se payant l’une de ses premières overdoses d’héro en compagnie de sa succube Courtney. Tout juste sorti de désintox, il apparaît très affaibli quelques jours avant la date fatidique. L’unique répétition pour le festival, effectuée la veille du jour J, est de l’aveu même de Dave Grohl un désastre, à tel point que le mercenaire de Washington craint que le trio ne se ridiculise et que le destin du gang grunge ne s’achève brutalement sous les huées. Seulement, quelques heures avant de monter sur scène, le frontman sort de son marasme et se prépare tant bien que mal à en découdre avec la foule... à sa façon.
L’entrée en lice de Kurt Cobain sur la main stage est mémorable : recroquevillé sur un fauteuil roulant, arborant une perruque blonde et une chemise d’hôpital immaculée, il se laisse soulever fébrilement par un roadie tandis que le colosse Novoselic assure à l’auditoire : "Avec l’aide de ses amis et de sa famille, il va y arriver !". Kurt s’approche du micro, aligne trois mots de chant, puis tombe à la renverse. Qu’on ne s’y trompe pas : cette mise en scène savamment chorégraphiée s’avère typique du paradigme cobainien, aussi caustique envers lui-même et ses propres démons qu’envers le monde extérieur. Ce petit numéro de théâtre lui est également bien utile pour préparer l’auditoire à excuser une potentielle catastrophe à venir, à raison dans un premier temps. L’entame du Live At Reading s’avère passablement poussive, le duo "Breed" - "Drain You" a énormément de mal à décoller, Cobain se bat avec son micro et avec sa voix, grimace, joue de traviole sous sa perruque peroxydée. Le second couplet de "Breed" est à la ramasse, les chutes de "Drain You", complètement étouffées, et la reprise après le pont s’étale de tout son long. Pendant que Dave Grohl mouline comme un beau diable dans sa forge ("Breed", d’un simple point de vue batterie, se révèle proprement inouï) et que Krist Novoselic bétonne ses lignes de basse en bondissant en souplesse, la gratte de Cobain connaît les pires difficultés à suivre le tempo et s’embourbe nonchalamment sur l’entame d’"Aneurysm". Ouch : Nirvana va-t-il crever sur scène en rendant les armes ?
Et là, le déclic, inopiné, insensé, inexplicable. Le petit punk se recroqueville en arrière, prend une grande respiration et balance du riff tord-boyaux direct dans les entrailles de l’assemblée. D’abord gauche et timoré, le même "Aneurysm" explose alors avec une déflagration invraisemblable, bien vite suivi par un "School" aux petits oignons. Incroyable. On peut dès lors se laisser enfin emporter par le son monstrueux du power trio, un son qui a été ici particulièrement encadré par le staff technique et qui rend vraiment honneur à l’escouade grunge. Alors que Novoselic se met en exergue de jouer les bonimenteurs habituels au micro, Cobain le rattrape, le coupe, s’adresse à la foule d’une voix fatiguée. Moment surréaliste, jeu de passe-passe entre les deux potes avec regards entendus, Grohl sourit niaisement avant que le blondinet n’entame "Sliver" en cabotinant comme un gosse, et là ça y est, on sent qu’il est présent, qu’il prend du plaisir, qu’il a envie de prouver que, putain, il n’est pas encore cuit. Sauf que la suite surnage entre deux eaux : décidément, Kurt Cobain a du mal à se dépatouiller des morceaux de Nevermind. On dirait qu’il n’arrive pas à leur pardonner toutes les crasses dont ils sont responsables à son égard. Le prophète des ados-X enlise sa voix ("In Bloom"), se replie en un solo autistique au rythme d’un balancement psychotique déconcertant ("Come As You Are", un peu vaseux par ailleurs), flâne mollement et loupe trois fois l’entame de "Lithium" avant de se battre à bras le corps avec la totalité du morceau malgré le support inconditionnel d’une foule qui scande les paroles à l’unisson. La fin du titre nous montre un frontman épuisé et dépité qui se barre de la scène sans un mot. Malaise.
Novoselic, avec son habituelle candeur gênée, tente de détendre l’atmosphère en ébauchant une histoire drôle, mais Cobain, après avoir réinvesti les lieux d’un pas frondeur, le coupe sans ménagement au son du riff tonique d’”About A Girl", et c’est encore un moment unique, fantastique. "About A Girl" est intrinsèquement le meilleur morceau de Bleach, et il fait ici mal, très mal. La fragilité affichée il y a quelques instants laisse place à une assurance bravache qui pousse le meneur à surjouer son aplomb en haussant le bras et l’épaule droite d’un air vengeur tout en déballant placidement ses accords. A ce stade, et à quelques exceptions prêt, Cobain ne lâchera plus rien, que ce soit sur les barouds punk harangueurs qu’il survole littéralement ("Tourette’s", complètement survolté) ou sur les pièces plus retenues ("Polly", premier véritable morceau de Nevermind à se trouver parfaitement mis en valeur), jusqu’à l’apothéose "Smells Like Teen Spirit”. On le sait, Cobain en est venu à haïr cette chanson, celle qui a fait de lui, contre sa volonté, l’idole d’une génération, mais il lui rend ici un hommage détonnant, n’hésitant pas à égratigner sciemment ses parties de guitare et à hurler sa rage comme un condamné à mort - ce qu’il est effectivement alors, d’une certaine façon. A compter de ce coup de Jarnac, l’affaire est entendue : malgré ses innombrables heurts initiaux, le Live At Reading est destiné à rester dans les annales.
Bien que s’étant tenu en 1992, soit deux ans avant le suicide de Cobain, ce concert possède une setlist idéale qui fait de facto de son enregistrement un best-of particulièrement fourni. Outre la totalité des morceaux de Nevermind, on y trouve aussi bon nombre de tueries de Bleach ("School" et "About A Girl" mais aussi les brûlots "Negative Creep" et "Blew"), trois belles B-Sides présentes dans Insecticide ("Been A Son", "Aneurysm" et "Sliver", sans compter "Spank Thru" de l’époque Bleach) mais surtout de nombreux inédits qui trouveront leur place plus d’une année plus tard sur In Utero, tel l’hystérique "Tourette’s", le tranquille "Dumb" et surtout "All Apologies", interprété alors pour la première fois par le trio. La présentation de ce dernier morceau apparaît également digne d’intérêt, Cobain dédiant la chanson à sa fille tout juste née et à Courtney Love tout en demandant à l’assemblée de reprendre en choeur "Courtney, we love you" au prétexte que les journalistes n’arrêtent pas d’écrire des saloperies sur elle. Regardez bien les yeux de Cobain à ce moment là. Pas son sourire coincé, non, ses yeux, la tristesse qui s’en dégage, son désarroi face à cette foule hilare qui reproduit sur l’instant le moindre de ses désirs. Observez sa fuite mentale tandis qu’il accorde sa guitare avant d’entamer le titre, une fuite qui le fait d’ailleurs complètement louper le morceau. Deux minutes à peine qui résument intégralement le drame cobainien, ses sautes d’humeur, son fardeau public, son ambivalence face au succès et son auto-dérision douloureusement corrosive.
Plus qu’une performance, le Live At Reading est avant tout un témoignage, celui du groupe de rock qui a redéfini la face du monde en 1991 et qui l’a payé au prix fort. Le spectacle y est réduit à son strict minimum : une scène immense, les trois larrons, et de temps à autres un quatrième gus qui vient s’agiter au milieu de la scène en sautant dans tous les sens à la mode de Madchester. Reclus derrière ses fûts, Dave Grohl, la tête rentrée dans les épaules, fait ce qu’on attend de lui, à savoir bastonner sans retenue, et il y excelle, le bougre. Impossible d’apercevoir la moindre parcelle de son visage tant son être tout entier fait corps avec son drum-kit, et lui d’envoyer la sauce à bloc, frappant les peaux de toute sa stature et avec l’énergie d’un démon des enfers. Novoselic, lui, c’est le roc jovial du groupe, le géant sur lequel tout le monde s’appuie, celui qui pâlie les carences de communication du chef de meute, qui sourit, qui détend l’atmosphère, qui remercie le public et qui, accessoirement, bondit et fait rugir sa basse comme à l’accoutumée, avec sérieux, envie et décontraction.
Reste le cas Cobain sur lequel on s’est déjà largement épanché, un peu perdu face à cette plèbe toute acquise à sa cause, souvent à son affaire et frôlant le divin mais parfois aussi complètement à côté de la plaque, statique derrière son micro ou replié en arrière sur ses solos effectués en égoïstes. Unies envers et contre tout, les trois personnalités envisagent pourtant la "tradition" de la destruction d’instruments en fin de concert de façon radicalement différente : Novoselic se marre et joue au lasso avec les débris de sa quatre cordes tandis que Grohl fait le discobole avec les cymbales en prenant pour cible ses caisses méthodiquement empilées, Seul Kurt Cobain, encore lui, vit pleinement ce moment avec introspection en se laissant emporter dans une transe errante qui l’amène à s’effondrer sur les amplis tout en déflorant l’hymne américain à grands renforts de larsens horrifiants. Un autre américain avait commis ce sacrilège sur le sol anglais quelques vingt années plus tôt, un certain Jimi Hendrix, lui aussi guitariste gaucher, lui aussi originaire de Seattle, lui aussi mort à 27 ans. Tout un symbole qui conclue un live apparaissant, sinon comme un grand moment de musique, du moins comme un grand, un très grand moment de rock n’ roll.